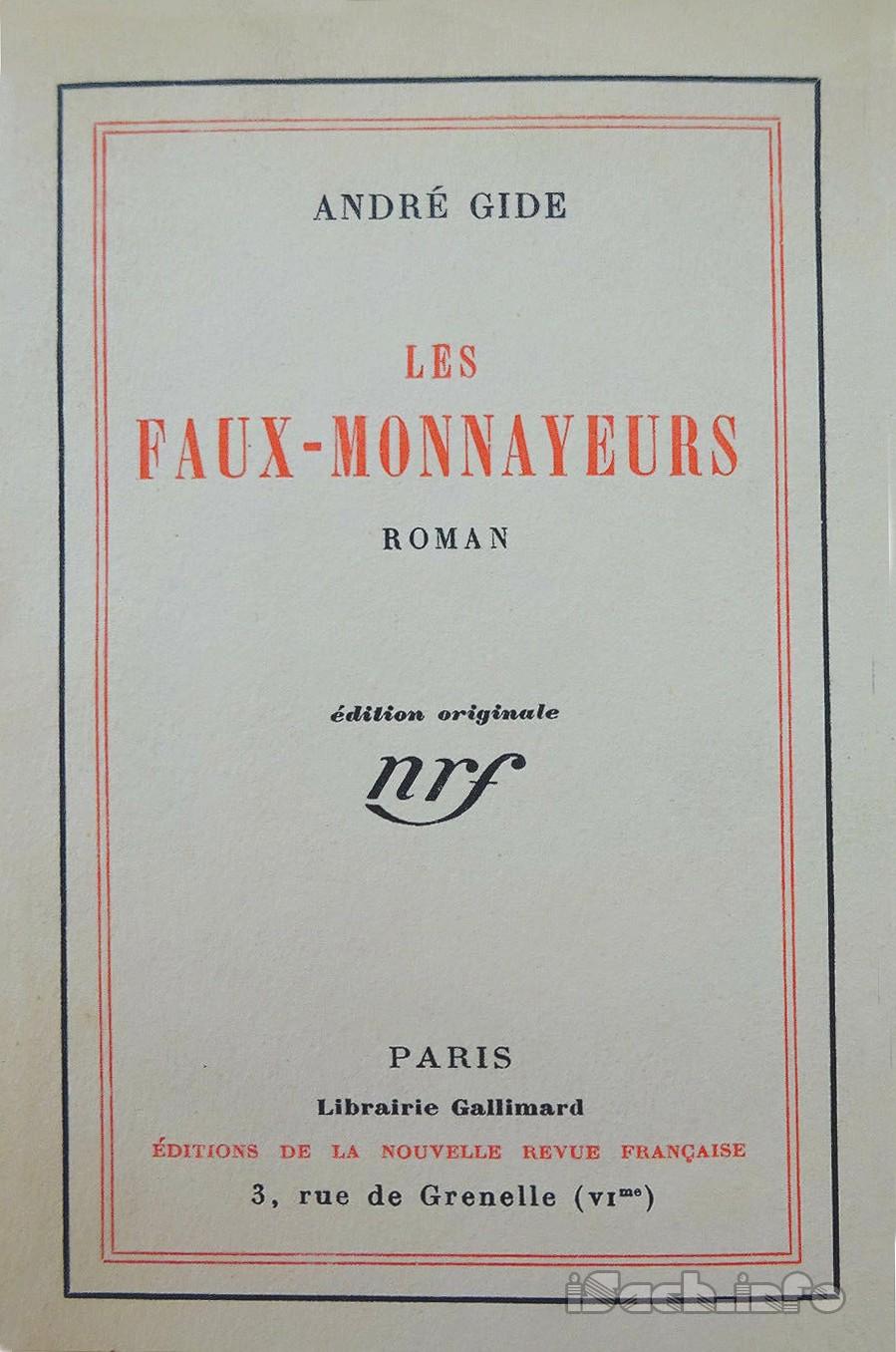Deuxième Partie
I
DE BERNARD À OLIVIER
Lundi.
« Cher Vieux,
« Que je te dise d’abord que j’ai séché le bachot. Tu l’auras compris sans doute en ne m’y voyant pas. Je me présenterai en octobre. Une occasion unique s’est offerte à moi de partir en voyage. J’ai sauté dessus; et je ne m’en repens pas. Il fallait se décider tout de suite; je n’ai pas pris le temps de réfléchir, pas même de te dire adieu. À ce propos, je suis chargé de t’exprimer tous les regrets de mon compagnon de voyage d’être parti sans te revoir. Car sais-tu qui m’emmenait? Tu le devines déjà… c’est Édouard, c’est ton fameux oncle, que j’ai rencontré le soir même de son arrivée à Paris, dans des circonstances assez extraordinaires et sensationnelles, que je te raconterai plus tard. Mais tout est extraordinaire dans cette aventure et, quand j’y repense, la tête me tourne. Encore aujourd’hui j’hésite à croire que c’est vrai, que c’est bien moi qui t’écris ceci, qui suis ici en Suisse avec Édouard et… Allons, il faut bien tout te dire, mais surtout déchire ma lettre et garde tout cela pour toi.
« Imagine-toi que cette pauvre femme abandonnée par ton frère Vincent, celle que tu entendais sangloter, une nuit, près de ta porte (et à qui tu as été bien idiot de ne pas ouvrir, permets-moi de te le dire), se trouve être une grande amie d’Édouard, la propre fille de Vedel, la sœur de ton ami Armand. Je ne devrais pas te raconter tout cela, car il y va de l’honneur d’une femme, mais je crèverais si je ne le racontais à personne… Encore une fois: garde cela pour toi. Tu sais déjà qu’elle venait de se marier; tu sais peut-être que, peu de temps après son mariage, elle est tombée malade et qu’elle est allée se soigner dans le Midi. C’est là qu’elle a fait la connaissance de Vincent, à Pau. Tu sais peut-être encore cela. Mais ce que tu ne sais pas, c’est que cette rencontre a eu des suites. Oui, mon vieux! Ton sacré maladroit de frère lui a fait un enfant. Elle est revenue enceinte à Paris, où elle n’a plus osé reparaître devant ses parents; encore moins osait-elle rentrer au foyer conjugal. Cependant ton frère la plaquait dans les conditions que tu sais. Je t’épargne les commentaires, mais puis-je te dire que Laura Douviers n’a pas eu un mot de reproches et de ressentiment contre lui. Au contraire, elle invente tout ce qu’elle peut pour excuser sa conduite. Bref, c’est une femme très bien, une tout à fait belle nature. Et quelqu’un qui est décidément très bien aussi, c’est Édouard. Comme elle ne savait plus que faire, ni où aller, il lui a proposé de l’emmener en Suisse; et du même coup il m’a proposé de les accompagner, parce que ça le gênait de voyager en tête à tête avec elle, vu qu’il n’a pour elle que des sentiments d’amitié. Nous voici donc partis tous les trois. Ça s’est décidé en cinq sec; juste le temps de faire ses valises et de me nipper (car tu sais que j’avais quitté la maison sans rien). Ce qu’Édouard a été gentil en la circonstance, tu ne peux t’en faire une idée; et de plus, il me répétait tout le temps que c’était moi qui lui rendais service. Oui, mon vieux, tu ne m’avais pas menti: ton oncle est un type épatant.
« Le voyage a été assez pénible parce que Laura était très fatiguée et que son état (elle commence son troisième mois de grossesse) exigeait beaucoup de ménagements; et que l’endroit où nous avions résolu d’aller (pour des raisons qu’il serait trop long de te dire) est d’accès assez difficile. Laura du reste compliquait souvent les choses en refusant de prendre des précautions; il fallait l’y forcer; elle répétait tout le temps qu’un accident était ce qui pourrait lui arriver de plus heureux. Tu penses si nous étions aux petits soins avec elle. Ah! mon ami, quelle femme admirable! Je ne me sens plus le même qu’avant de l’avoir connue et il y a des pensées que je n’ose plus formuler, des mouvements de mon cœur que je refrène, parce que j’aurais honte de ne pas être digne d’elle. Oui, vraiment, près d’elle, on est comme forcé de penser noblement. Cela n’empêche pas que la conversation entre nous trois est très libre, car Laura n’es pas bégueule du tout – et nous parlons de n’importe quoi; mais je t’assure que, devant elle, il y a des tas de choses que je n’ai plus du tout envie de blaguer et qui me paraissent aujourd’hui très sérieuses.
« Tu vas croire que je suis amoureux d’elle. Eh bien! mon vieux, tu ne te tromperais pas. C’est fou, n’est-ce pas? Me vois-tu amoureux d’une femme enceinte, que naturellement je respecte, et n’oserais pas toucher du bout du doigt? Tu vois que je ne tourne pas au noceur…
« Quand nous sommes arrivés à Saas-Fée, après des difficultés sans nombre (nous avions pris une chaise à porteurs pour Laura, car les voitures ne parviennent pas jusqu’ici), l’hôtel n’a pu nous offrir que deux chambres, une grande à deux lits et une petite, qu’il a été convenu devant l’hôtelier que je prendrais – car, pour cacher son identité, Laura passe pour la femme d’Édouard; mais chaque nuit c’est elle qui occupe la petite chambre et je vais retrouver Édouard dans la sienne. Chaque matin c’est tout un trimbalement pour donner le change aux domestiques. Heureusement, les deux chambres communiquent, ce qui simplifie.
« Voilà six jours que nous sommes ici; je ne t’ai pas écrit plus tôt parce que j’étais d’abord trop désorienté et qu’il fallait que je me mette d’accord avec moi-même. Je commence seulement à m’y reconnaître.
« Nous avons déjà fait, Édouard et moi, quelques petites courses de montagne, très amusantes; mais à vrai dire, ce pays ne me plaît pas beaucoup; à Édouard non plus. Il trouve le paysage « déclamatoire ». C’est tout à fait ça.
« Ce qu’il y a de meilleur ici, c’est l’air qu’on y respire; un air vierge et qui vous purifie les poumons. Et puis nous ne voulons pas laisser Laura trop longtemps seule, car il va sans dire qu’elle ne peut pas nous accompagner. La société de l’hôtel est assez divertissante. Il y a des gens de toutes les nationalités. Nous fréquentons surtout une doctoresse polonaise, qui passe ici ses vacances avec sa fille et un petit garçon qu’on lui a confié. C’est même pour retrouver cet enfant que nous sommes venus jusqu’ici. Il a une sorte de maladie nerveuse que la doctoresse soigne selon une méthode toute nouvelle. Mais ce qui fait le plus de bien au petit, très sympathique ma foi, c’est d’être amoureux fou de la fille de la doctoresse, de quelques années plus âgée que lui et qui est bien la plus jolie créature que j’aie vue de ma vie. Du matin au soir ils ne se quittent pas. Ils sont si gentils tous les deux ensemble que personne ne songe à les blaguer.
« Je n’ai pas beaucoup travaillé, et pas ouvert un livre depuis mon départ; mais beaucoup réfléchi. La conversation d’Édouard est d’un intérêt prodigieux. Il ne me parle pas beaucoup directement, bien qu’il affecte de me traiter en secrétaire; mais je l’écoute causer avec les autres; avec Laura surtout, à qui il aime raconter ses projets. Tu ne peux pas te rendre compte de quel profit cela est pour moi. Certains jours je me dis que je devrais prendre des notes; mais je crois que je retiens tout. Certains jours je te souhaite éperdument; je me dis que c’est toi qui devrais être ici; mais je ne puis regretter ce qui m’arrive, ni souhaiter y rien changer. Du moins dis-toi bien que je n’oublie pas que c’est grâce à toi que je connais Édouard, et que je te dois mon bonheur. Quand tu me reverras, je crois que tu me trouveras changé; mais je ne demeure pas moins et plus profondément que jamais ton ami.
Mercredi.
« P.-S. – Nous rentrons à l’instant d’une course énorme. Ascension de l’Hallalin – guides encordés avec nous, glaciers, précipices, avalanches, etc. Couchés dans un refuge au milieu des neiges, empilés avec d’autres touristes; inutile de te dire que nous n’avons pas fermé l’œil de la nuit. Le lendemain, départ avant l’aube… Eh bien! mon vieux, je ne dirai plus de mal de la Suisse: quand on est là-haut, qu’on a perdu de vue toute culture, toute végétation, tout ce qui rappelle l’avarice et la sottise des hommes, on a envie de chanter, de rire, de pleurer, de voler, de piquer une tête en plein ciel ou de se jeter à genoux. Je t’embrasse.
« Bernard. »
Bernard était beaucoup trop spontané, trop naturel, trop pur, il connaissait trop mal Olivier, pour se douter du flot de sentiments hideux que cette lettre allait soulever chez celui-ci; une sorte de raz de marée où se mêlait du dépit, du désespoir et de la rage. Il se sentait à la fois supplanté dans le cœur de Bernard et dans celui d’Édouard. L’amitié de ses deux amis évinçait la sienne. Une phrase surtout de la lettre de Bernard le torturait, que Bernard n’aurait jamais écrite s’il avait pressenti tout ce qu’Olivier pourrait y voir: « Dans la même chambre », se répétait-il – et l’abominable serpent de la jalousie se déroulait et se tordait en son cœur. « Ils couchent dans la même chambre!… » Que n’imaginait-il pas aussitôt? Son cerveau s’emplissait de visions impures qu’il n’essayait même pas de chasser. Il n’était jaloux particulièrement ni d’Édouard, ni de Bernard; mais des deux. Il les imaginait tour à tour l’un et l’autre ou simultanément, et les enviait à la fois. Il avait reçu la lettre à midi. « Ah! c’est ainsi… », se redisait-il tout le restant du jour. Cette nuit, les démons de l’enfer l’habitèrent. Le lendemain matin il se précipita chez Robert. Le comte de Passavant l’attendait.
II
JOURNAL D’ÉDOUARD
« Je n’ai pas eu de mal à trouver le petit Boris. Le lendemain de notre arrivée, il s’est amené sur la terrasse de l’hôtel et a commencé de regarder les montagnes à travers une longue-vue montée sur pivot, mise à la disposition des voyageurs. Je l’ai reconnu tout de suite. Une fillette un peu plus grande que Boris l’a bientôt rejoint. J’étais installé tout auprès, dans le salon dont la porte-fenêtre restait ouverte, et ne perdais pas un mot de leur conversation. J’avais grande envie de lui parler, mais j’ai cru plus prudent d’entrer d’abord en relation avec la mère de la petite fille, une doctoresse polonaise à qui Boris a été confié, et qui le surveille de très près. La petite Bronja est exquise; elle doit avoir quinze ans. Elle porte en nattes d’épais cheveux blonds qui descendent jusqu’à sa taille; son regard et le son de sa voix semblent plutôt angéliques qu’humains. Je transcris les propos de ces deux enfants:
« “Boris, maman préfère que nous ne touchions pas à la lorgnette. Tu ne veux pas venir te promener?
« – Oui, je veux bien. Non, je ne veux pas.”
« Les deux phrases contradictoires étaient dites d’une seule haleine. Bronja ne retint que la seconde et reprit:
« “Pourquoi?
« – Il fait trop chaud, il fait trop froid.” (Il avait laissé la lorgnette.)
« “Voyons. Boris, sois gentil. Tu sais que cela ferait plaisir à maman que nous sortions ensemble. Où as-tu mis ton chapeau?
« – Vibroskomenopatof. Blaf blaf.
« – Qu’est-ce que ça veut dire?
« – Rien.
« – Alors pourquoi le dis-tu?
« – Pour que tu ne comprennes pas.
« – Si ça ne veut rien dire, ça m’est égal de ne pas comprendre.
« – Mais si ça voulait dire quelque chose, tu ne comprendrais tout de même pas.
« – Quand on parle, c’est pour se faire comprendre.
« – Veux-tu, nous allons jouer à faire des mots pour nous deux seulement les comprendre.
« – Tâche d’abord de bien parler français.
« – Ma maman, elle, parle le français, l’anglais, le romain, le russe, le turc, le polonais, l’italoscope, l’espagnol, le perruquoi et le xixitou.”
« Tout ceci dit très vite, dans une sorte de fureur lyrique.
« Bronja se mit à rire.
« “Boris, pourquoi est-ce que tu racontes tout le temps des choses qui ne sont pas vraies?
« – Pourquoi est-ce que tu ne crois jamais ce que je te raconte?
« – Je crois ce que tu me dis, quand c’est vrai.
« – Comment sais-tu quand c’est vrai? Moi je t’ai bien crue l’autre jour, quand tu m’as parlé des anges. Dis, Bronja: tu crois que si je priais très fort, moi aussi je les verrais?
« – Tu les verras peut-être, si tu perds l’habitude de mentir et si Dieu veut bien te les montrer; mais Dieu ne te les montrera pas si tu le pries seulement pour les voir. Il y a beaucoup de choses très belles que nous verrions si nous étions moins méchants.
« – Bronja, toi, tu n’es pas méchante, c’est pour ça que tu peux voir les anges. Moi je serai toujours un méchant.
« – Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à ne plus l’être? Veux-tu que nous allions tous les deux jusqu’à (ici l’indication d’un lieu que je ne connaissais pas) et là tous les deux nous prierons Dieu et la Sainte Vierge de t’aider à ne plus être méchant.
« – Oui. Non; écoute: on va prendre un bâton; tu tiendras un bout et moi l’autre. Je vais fermer les yeux et je te promets de ne les rouvrir que quand nous serons arrivés là-bas.”
« Ils s’éloignèrent un peu; et, tandis qu’ils descendaient les marches de la terrasse, j’entendis encore Boris:
« “Oui, non, pas ce bout-là. Attends que je l’essuie.
« – Pourquoi?
« – J’y ai touché.”
« Mme Sophroniska s’est approchée de moi, comme j’achevais seul mon déjeuner du matin et que précisément je cherchais le moyen de l’aborder. Je fus surpris de voir qu’elle tenait mon dernier livre à la main; elle m’a demandé, en souriant de la manière la plus affable, si c’était bien à l’auteur qu’elle avait le plaisir de parler; puis aussitôt s’est lancée dans une longue appréciation de mon livre. Son jugement, louanges et critiques, m’a paru plus intelligent que ceux que j’ai coutume d’entendre, encore que son point de vue ne soit rien moins que littéraire. Elle m’a dit s’intéresser presque exclusivement aux questions de psychologie et à ce qui peut éclairer d’un jour nouveau l’âme humaine. Mais combien rares, a-t-elle ajouté, les poètes, dramaturges ou romanciers qui savent ne point se contenter d’une psychologie toute faite (la seule, lui ai-je dit, qui puisse contenter les lecteurs).
« Le petit Boris lui a été confié pour les vacances par sa mère. Je me suis gardé de laisser paraître les raisons que j’avais de m’intéresser à lui. “Il est très délicat, m’a dit Mme Sophroniska. La société de sa mère ne lui vaut rien.” Elle parlait de venir à Saas-Fée avec nous; mais je n’ai accepté de m’occuper de l’enfant que si elle l’abandonnait complètement à mes soins; sinon je n’aurais pu répondre de ma cure. – Songez, Monsieur, a-t-elle continué, qu’elle entretient ce petit dans un état d’exaltation continuelle, qui favorise chez lui l’éclosion des pires troubles nerveux. Depuis la mort du père, cette femme doit gagner sa vie. Elle n’était que pianiste et je dois dire: une exécutante incomparable; mais son jeu trop subtil ne pouvait plaire au gros public. Elle s’est décidée à chanter dans les concerts, dans les casinos, à monter sur les planches. Elle emmenait Boris dans sa loge; je crois que l’atmosphère factice du théâtre a beaucoup contribué à déséquilibrer cet enfant. Sa mère l’aime beaucoup; mais à vrai dire, il serait souhaitable qu’il ne vécût plus avec elle.
« “Qu’a-t-il au juste?” ai-je demandé.
« Elle se mit à rire:
« “C’est le nom de sa maladie que vous voulez savoir? Ah! vous serez bien avancé quand je vous aurai dit un beau nom savant.
« – Dites-moi simplement ce dont il souffre.
« – Il souffre d’une quantité de petits troubles, de tics, de manies, qui font dire: c’est un enfant nerveux, et que l’on soigne d’ordinaire par le repos au grand air et par l’hygiène. Il est certain qu’un organisme robuste ne laisserait pas à ces troubles la licence de se produire. Mais si la débilité les favorise, elle ne les cause pas précisément. Je crois qu’on peut toujours trouver leur origine dans un premier ébranlement de l’être dû à quelque événement qu’il importe de découvrir. Le malade, dès qu’il devient conscient de cette cause, est à moitié guéri. Mais cette cause le plus souvent échappe à son souvenir; on dirait qu’elle se dissimule dans l’ombre de la maladie; c’est derrière cet abri que je la cherche, pour la ramener en plein jour, je veux dire dans le champ de la vision. Je crois qu’un regard clair nettoie la conscience comme un rayon de lumière purifie une eau infectée.”
« Je racontai à Sophroniska la conversation que j’avais surprise la veille et d’après laquelle il me paraissait que Boris était loin d’être guéri.
« “C’est aussi que je suis loin de connaître du passé de Boris tout ce que j’aurais besoin de connaître. Il n’y a pas longtemps que j’ai commencé mon traitement.
« – En quoi consiste-t-il?
« – Oh! simplement à le laisser parler. Chaque jour je passe près de lui une ou deux heures. Je le questionne, mais très peu. L’important est de gagner sa confiance. Déjà je sais beaucoup de choses. J’en pressens beaucoup d’autres. Mais le petit se défend encore, il a honte; si j’insistais trop vite et trop fort, si je voulais brusquer sa confidence, j’irais à l’encontre de ce que je souhaite obtenir: un complet abandon. Il se rebifferait. Tant que je ne serai pas parvenue à triompher de sa réserve, de sa pudeur…”
« L’inquisition dont elle me parlait me parut à ce point attentatoire que j’eus peine à retenir un mouvement de protestation; mais ma curiosité l’emportait.
« “Serait-ce à dire que vous attendez de ce petit quelques révélations impudiques?”
« Ce fut à elle de protester.
« “Impudiques? Il n’y a pas là plus d’impudeur qu’à se laisser ausculter. J’ai besoin de tout savoir et particulièrement ce que l’on a plus grand souci de cacher. Il faut que j’amène Boris jusqu’à l’aveu complet; avant cela je ne pourrai pas le guérir.
« – Vous soupçonnez donc qu’il a des aveux à vous faire? Êtes-vous bien certaine, excusez-moi, de ne pas lui suggérer ce que vous voudriez qu’il avoue?
« – Cette préoccupation ne doit pas me quitter et c’est elle qui m’enseigne tant de lenteur. J’ai vu des juges d’instruction maladroits souffler sans le vouloir à un enfant un témoignage inventé de toutes pièces et l’enfant, sous la pression d’un interrogatoire, mentir avec une parfaite bonne foi, donner créance à des méfaits imaginaires. Mon rôle est de laisser venir et surtout de ne rien suggérer. Il y faut une patience extraordinaire.
« – Je pense que la méthode, ici vaut ce que vaut l’opérateur.
« – Je n’osais le dire. Je vous assure qu’après quelque temps de pratique on arrive à une extraordinaire habileté, une sorte de divination, d’intuition si vous préférez. Du reste on peut parfois se lancer sur de fausses pistes; l’important c’est de ne pas s’y obstiner. Tenez: savez-vous comment débutent tous nos entretiens? Boris commence par me raconter ce qu’il a rêvé pendant la nuit.
« – Qui vous dit qu’il n’invente pas?
« – Et quand il inventerait?… Toute invention d’une imagination maladive est révélatrice.”
« Elle se tut quelques instants, puis:
« “Invention, imagination maladive… Non! ce n’est pas cela. Les mots nous trahissent. Boris, devant moi, rêve à voix haute. Il accepte tous les matins de demeurer, une heure durant, dans cet état de demi-sommeil où les images qui se proposent à nous échappent au contrôle de notre raison. Elles se groupent et s’associent, non plus selon la logique ordinaire, mais selon des affinités imprévues; surtout, elles répondent à une mystérieuse exigence intérieure, celle même qu’il m’importe de découvrir; et ces divagations d’un enfant m’instruisent bien plus que ne saurait faire la plus intelligente analyse du plus conscient des sujets. Bien des choses échappent à la raison, et celui qui, pour comprendre la vie, y applique seulement la raison, est semblable à quelqu’un qui prétendrait saisir une flamme avec des pincettes. Il n’a plus devant lui qu’un morceau de bois charbonneux, qui cesse aussitôt de flamber.”
« Elle s’arrêta de nouveau et commença à feuilleter mon livre.
« “Comme vous entrez donc peu avant dans l’âme humaine, s’écria-t-elle; puis elle ajouta brusquement en riant: – Oh! je ne parle pas de vous spécialement; quand je dis: vous, j’entends: les romanciers. La plupart de vos personnages semblent bâtis sur pilotis; ils n’ont ni fondation, ni sous-sol. Je crois vraiment qu’on trouve plus de vérité chez les poètes; tout ce qui n’est créé que par la seule intelligence est faux. Mais je parle ici de ce qui ne me regarde pas… Savez-vous ce qui me désoriente dans Boris? C’est que je le crois d’une très grande pureté.
« – Pourquoi dites-vous que cela vous désoriente?
« – Parce qu’alors je ne sais plus où chercher la source du mal. Neuf fois sur dix on trouve à l’origine d’un dérangement semblable un gros secret honteux.
« – On le trouve en chacun de nous, peut-être, dis-je, mais il ne nous rend pas tous malades, Dieu merci.”
« À ce moment, Mme Sophroniska se leva; elle venait de voir à la fenêtre passer Bronja.
« “Tenez, dit-elle en me la montrant; le voilà, le vrai médecin de Boris. Elle me cherche; il faut que je vous quitte; mais je vous reverrai, n’est-ce pas?
« Je comprends de reste ce que Sophroniska reproche au roman de ne point lui offrir; mais ici certaines raisons d’art, certaines raisons supérieures, lui échappent qui me font penser que ce n’est pas d’un bon naturaliste qu’on peut faire un bon romancier.
« J’ai présenté Laura à Mme Sophroniska. Elles semblent s’entendre et j’en suis heureux. J’ai moins scrupule à m’isoler lorsque je sais qu’elles bavardent ensemble. Je regrette que Bernard ne trouve ici aucun compagnon de son âge; mais du moins son examen à préparer l’occupe de son côté plusieurs heures par jour. J’ai pu me remettre à mon roman. »
III
Malgré la première apparence, et encore que chacun, comme l’on dit, « y mît du sien », cela n’allait qu’à moitié bien entre l’oncle Édouard et Bernard. Laura non plus ne se sentait pas satisfaite. Et comment eût-elle pu l’être? Les circonstances l’avaient forcée d’assumer un rôle pour lequel elle n’était point née; son honnêteté l’y gênait. Comme ces créatures aimantes et dociles qui font les épouses les plus dévouées elle avait besoin, pour prendre appui, des convenances, et se sentait sans force depuis qu’elle était désencadrée. Sa situation vis-à-vis d’Édouard lui paraissait de jour en jour plus fausse. Ce dont elle souffrait surtout et qui, pour peu que s’y attardât sa pensée, lui devenait insupportable, c’était de vivre aux dépens de ce protecteur, ou mieux: de ne lui donner rien en échange; ou plus exactement encore: c’était qu’Édouard ne lui demandât rien en échange, alors qu’elle se sentait prête à tout lui accorder. « Les bienfaits, dit Tacite à travers Montaigne, ne sont agréables que tant que l’on peut s’acquitter »; et sans doute cela n’est vrai que pour les âmes nobles, mais Laura certes était de celles-ci. Alors qu’elle eût voulu donner, c’était elle qui recevait sans cesse, et ceci l’irritait contre Édouard. De plus, lorsqu’elle se remémorait le passé, il lui paraissait qu’Édouard l’avait trompée en éveillant en elle un amour qu’elle sentait encore vivace, puis en se dérobant à cet amour et en le laissant sans emploi. N’était-ce pas là le secret motif de ses erreurs, de son mariage avec Douviers, auquel elle s’était résignée, auquel Édouard l’avait conduite; puis de son laisser-aller, sitôt ensuite, aux sollicitations du printemps? Car, elle devait bien se l’avouer, dans les bras de Vincent, c’était Édouard encore qu’elle cherchait. Et, ne s’expliquant pas cette froideur de son amant, elle s’en faisait responsable, se disait qu’elle l’eût pu vaincre, si plus belle ou si plus hardie; et, ne parvenant pas à le haïr, elle s’accusait elle-même, se dépréciait, se déniait toute valeur, et supprimait sa raison d’être, et ne se reconnaissait plus de vertu.
Ajoutons encore que cette vie de campement, imposée par la disposition des chambres, et qui pouvait paraître si plaisante à ses compagnons, froissait en elle mainte pudeur. Et elle n’entrevoyait aucune issue à cette situation, pourtant difficilement prolongeable.
Laura ne puisait un peu de réconfort et de joie qu’en s’inventant vis-à-vis de Bernard de nouveaux devoirs de marraine ou de sœur aînée. Elle était sensible à ce culte que lui vouait cet adolescent plein de grâce; l’adoration dont elle était l’objet la retenait sur la pente de ce mépris de soi-même, de ce dégoût, qui peut mener à des résolutions extrêmes les êtres les plus irrésolus. Bernard chaque matin, quand une excursion en montagne ne l’entraînait pas avant l’aube (car il aimait se lever tôt), passait deux pleines heures auprès d’elle à lire de l’anglais. L’examen auquel il devait se présenter en octobre était un prétexte commode.
On ne pouvait vraiment pas dire que ses fonctions de secrétaire lui prissent beaucoup de temps. Elles étaient mal définies. Bernard, lorsqu’il les avait assumées, s’imaginait déjà assis devant une table de travail, écrivant sous la dictée d’Édouard, mettant au net des manuscrits. Édouard ne dictait rien; les manuscrits, si tant est qu’il y en eût, restaient enfermés dans la malle; à toute heure du jour, Bernard avait sa liberté; mais comme il ne tenait qu’à Édouard d’utiliser davantage un zèle qui ne demandait qu’à s’employer, Bernard ne se faisait point trop souci de sa vacance et de ne gagner point cette vie assez large que grâce à la munificence d’Édouard il menait. Il était bien résolu à ne se laisser point embarrasser par les scrupules. Il croyait, je n’ose dire à la providence, mais bien du moins à son étoile, et qu’un certain bonheur lui était dû tout comme l’air aux poumons qui le respirent; Édouard en était le dispensateur au même titre que l’orateur sacré, selon Bossuet, celui de la sagesse divine. Au surplus, le régime présent, Bernard le tenait pour provisoire, pensant bien se pouvoir acquitter un jour, et dès qu’il aurait monnayé les richesses dont il soupesait en son cœur l’abondance. Ce qui le dépitait plutôt, c’est qu’Édouard ne fît point appel à certains dons qu’il sentait en lui et qu’il ne retrouvait pas dans Édouard. « Il ne sait pas m’utiliser », pensait Bernard, qui ravalait son amour-propre et, sagement, ajoutait aussitôt: « Tant pis. »
Mais alors, entre Édouard et Bernard, d’où pouvait provenir la gêne? Bernard me paraît être de cette sorte d’esprits qui trouvent dans l’opposition leur assurance. Il ne supportait pas qu’Édouard prît ascendant sur lui, et, devant que de céder à l’influence, il regimbait. Édouard, qui ne songeait aucunement à le plier, tour à tour s’irritait et se désolait à le sentir rétif, prêt à se défendre sans cesse, ou du moins à se protéger. Il en venait donc à douter s’il n’avait pas fait un pas de clerc en emmenant avec lui ces deux êtres qu’il n’avait réunis, semblait-il, que pour les liguer contre lui. Incapable de pénétrer les sentiments secrets de Laura, il prenait pour de la froideur son retrait et ses réticences. Il eût été bien gêné d’y voir clair et c’est ce que Laura comprenait; de sorte que son amour dédaigné n’employait plus sa force qu’à se cacher et à se taire.
L’heure du thé les rassemblait à l’ordinaire tous trois dans la grande chambre; il arrivait souvent que, sur leur invite, Mme Sophroniska se joignait à eux; principalement les jours où Boris et Bronja étaient partis en promenade. Elle les laissait très libres malgré leur jeune âge; elle avait parfaite confiance en Bronja, la connaissait pour très prudente, et particulièrement avec Boris, qui se montrait particulièrement docile avec elle. Le pays était sûr; car il n’était pas question pour eux, certes, de s’aventurer en montagne, ni même d’escalader les rochers proches de l’hôtel. Certain jour que les deux enfants avaient obtenu la permission d’aller jusqu’au pied du glacier, à condition de ne s’écarter point de la route, Mme Sophroniska, conviée au thé et encouragée par Bernard et par Laura, s’enhardit jusqu’à oser prier Édouard de leur parler de son futur roman, si toutefois cela ne lui était pas désagréable.
« Nullement; mais je ne puis vous le raconter. »
Pourtant il sembla presque se fâcher, lorsque Laura lui demanda (question évidemment maladroite) « à quoi ce livre ressemblerait ».
« À rien, s’était-il écrié; puis aussitôt, et comme s’il n’avait attendu que cette provocation – Pourquoi refaire ce que d’autres que moi ont déjà fait, ou ce que j’ai déjà fait moi-même, ou ce que d’autres que moi pourraient faire? »
Édouard n’eut pas plutôt proféré ces paroles qu’il en sentit l’inconvenance et l’outrance et l’absurdité; du moins, ces paroles lui parurent-elles inconvenantes et absurdes; ou du moins craignait-il qu’elles n’apparussent telles au jugement de Bernard.
Édouard était très chatouilleux. Dès qu’on lui parlait de son travail, et surtout dès qu’on l’en faisait parler, on eût dit qu’il perdait la tête.
Il tenait en parfait mépris la coutumière fatuité des auteurs; il mouchait de son mieux la sienne propre; mais il cherchait volontiers dans la considération d’autrui un renfort à sa modestie; cette considération venait-elle à manquer, la modestie tout aussitôt faisait faillite. L’estime de Bernard lui importait extrêmement. Était-ce pour la conquérir qu’Édouard, aussitôt devant lui, laissait son Pégase piaffer? Le meilleur moyen pour la perdre. Édouard le sentait bien; il se le disait et se le répétait; mais, en dépit de toute résolution, sitôt devant Bernard, il agissait tout autrement qu’il eût voulu, et parlait d’une manière qu’il jugeait tout aussitôt absurde (et qui l’était en vérité). À quoi l’on aurait pu penser qu’il l’aimait?… Mais non; je ne crois pas. Pour obtenir de nous de la grimace, aussi bien que beaucoup d’amour, un peu de vanité suffit.
« Est-ce parce que, de tous les genres littéraires, discourait Édouard, le roman reste le plus libre, le plus lawless…, est-ce peut-être pour cela, par peur de cette liberté même (car les artistes qui soupirent le plus après la liberté, sont les plus affolés souvent, dès qu’ils l’obtiennent) que le roman, toujours, s’est si craintivement cramponné à la réalité? Et je ne parle pas seulement du roman français. Tout aussi bien que le roman anglais, le roman russe, si échappé qu’il soit de la contrainte, s’asservit à la ressemblance. Le seul progrès qu’il envisage, c’est de se rapprocher encore plus du naturel. Il n’a jamais connu, le roman, cette “formidable érosion des contours”, dont parle Nietzsche, et ce volontaire écartement de la vie, qui permirent le style, aux œuvres des dramaturges grecs par exemple, ou aux tragédies du XVIIe siècle français. Connaissez-vous rien de plus parfait et de plus profondément humain que ces œuvres? Mais précisément, cela n’est humain que profondément; cela ne se pique pas de le paraître, ou du moins de paraître réel. Cela demeure une œuvre d’art. »
Édouard s’était levé, et, par grande crainte de paraître faire un cours, tout en parlant il versait le thé, puis allait et venait, puis pressait un citron dans sa tasse, mais tout de même continuait:
« Parce que Balzac était un génie, et parce que tout génie semble apporter à son art une solution définitive et exclusive, l’on a décrété que le propre du roman était de faire “concurrence à l’état civil”. Balzac avait édifié son œuvre; mais il n’avait jamais prétendu codifier le roman; son article sur Stendhal le montre bien. Concurrence à l’état civil! Comme s’il n’y avait pas déjà suffisamment de magots et de paltoquets sur la terre! Qu’ai-je affaire à l’état-civil! L’état c’est moi, l’artiste; civile ou pas, mon œuvre prétend ne concurrencer rien. »
Édouard qui se chauffait, un peu facticement peut-être, se rassit. Il affectait de ne regarder point Bernard; mais c’était pour lui qu’il parlait. Seul avec lui, il n’aurait rien su dire; il était reconnaissant à ces deux femmes de le pousser.
« Parfois il me paraît que je n’admire en littérature rien tant que, par exemple, dans Racine, la discussion entre Mithridate et ses fils; où l’on sait parfaitement bien que jamais un père et des fils n’ont pu parler de la sorte et où néanmoins (et je devrais dire: d’autant plus) tous les pères et tous les fils peuvent se reconnaître. En localisant et en spécifiant, l’on restreint. Il n’y a de vérité psychologique que particulière, il est vrai; mais il n’y a d’art que général. Tout le problème est là, précisément; exprimer le général par le particulier; faire exprimer par le particulier le général. Vous permettez que j’allume ma pipe?
– Faites donc, faites donc, dit Sophroniska.
– Eh bien! je voudrais un roman qui serait à la fois aussi vrai, et aussi éloigné de la réalité, aussi particulier et aussi général à la fois, aussi humain et aussi fictif qu’Athalie, que Tartuffe ou que Cinna.
– Et… le sujet de ce roman?
– Il n’en a pas, repartit Édouard brusquement; et c’est là ce qu’il a de plus étonnant peut-être. Mon roman n’a pas de sujet. Oui, je sais bien; ça a l’air stupide ce que je dis là. Mettons si vous préférez qu’il n’y aura pas un sujet… “Une tranche de vie”, disait l’école naturaliste. Le grand défaut de cette école, c’est de couper sa tranche toujours dans le même sens; dans le sens du temps, en longueur. Pourquoi pas en largeur? ou en profondeur? Pour moi, je voudrais ne pas couper du tout. Comprenez-moi: je voudrais tout y faire entrer, dans ce roman. Pas de coup de ciseaux pour arrêter, ici plutôt que là, sa substance. Depuis plus d’un an que j’y travaille, il ne m’arrive rien que je n’y verse, et que je n’y veuille faire entrer: ce que je vois, ce que je sais, tout ce que m’apprend la vie des autres et la mienne…
– Et tout cela stylisé? dit Sophroniska, feignant l’attention la plus vive, mais sans doute avec un peu d’ironie. Laura ne put réprimer un sourire. Édouard haussa légèrement les épaules et reprit:
– Et ce n’est même pas cela que je veux faire. Ce que je veux, c’est présenter d’une part la réalité, présenter d’autre part cet effort pour la styliser, dont je vous parlais tout à l’heure.
– Mon pauvre ami, vous ferez mourir d’ennui vos lecteurs, dit Laura; ne pouvant plus cacher son sourire, elle avait pris le parti de rire vraiment.
– Pas du tout. Pour obtenir cet effet, suivez-moi, j’invente un personnage de romancier, que je pose en figure centrale; et le sujet du livre, si vous voulez, c’est précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que, lui, prétend en faire.
– Si, si; j’entrevois, dit poliment Sophroniska, que le rire de Laura était bien près de gagner. – Ce pourrait être assez curieux. Mais, vous savez, dans les romans, c’est toujours dangereux de présenter des intellectuels. Ils assomment le public; on ne parvient à leur faire dire que des âneries, et, à tout ce qui les touche, ils communiquent un air abstrait.
– Et puis je vois très bien ce qui va arriver, s’écria Laura: dans ce romancier, vous ne pourrez faire autrement que de vous peindre. »
Elle avait pris, depuis quelque temps, en parlant à Édouard, un ton persifleur qui l’étonnait elle-même, et qui désarçonnait Édouard d’autant plus qu’il en surprenait un reflet dans les regards malicieux de Bernard. Édouard protesta:
« Mais non; j’aurai soin de le faire très désagréable. »
Laura était lancée:
« C’est cela: tout le monde vous y reconnaîtra, dit-elle en éclatant d’un rire si franc qu’il entraîna celui des trois autres.
– Et le plan de ce livre est fait? demanda Sophroniska, en tâchant de reprendre son sérieux.
– Naturellement pas.
– Comment! naturellement pas?
– Vous devriez comprendre qu’un plan, pour un livre de ce genre, est essentiellement inadmissible. Tout y serait faussé si j’y décidais rien par avance. J’attends que la réalité me le dicte.
– Mais je croyais que vous vouliez vous écarter de la réalité.
– Mon romancier voudra s’en écarter; mais moi je l’y ramènerai sans cesse. À vrai dire, ce sera là le sujet: la lutte entre les faits proposés par la réalité, et la réalité idéale. »
L’illogisme de son propos était flagrant, sautait aux yeux d’une manière pénible. Il apparaissait clairement que, sous son crâne, Édouard abritait deux exigences inconciliables, et qu’il s’usait à les vouloir accorder.
« Et c’est très avancé? demanda poliment Sophroniska.
– Cela dépend de ce que vous entendez par là. À vrai dire, du livre même, je n’ai pas encore écrit une ligne. Mais j’y ai déjà beaucoup travaillé. J’y pense chaque jour et sans cesse. J’y travaille d’une façon très curieuse, que je m’en vais vous dire: sur un carnet, je note au jour le jour l’état de ce roman dans mon esprit; oui, c’est une sorte de journal que je tiens, comme on ferait celui d’un enfant… C’est-à-dire qu’au lieu de me contenter de résoudre, à mesure qu’elle se propose, chaque difficulté (et toute œuvre d’art n’est que la somme ou le produit des solutions d’une quantité de menues difficultés successives), chacune de ces difficultés, je l’expose, je l’étudie. Si vous voulez, ce carnet contient la critique de mon roman; ou mieux: du roman en général. Songez à l’intérêt qu’aurait pour nous un semblable carnet tenu par Dickens, ou Balzac; si nous avions le journal de L’Éducation sentimentale, ou des Frères Karamazov! l’histoire de l’œuvre, de sa gestation! Mais ce serait passionnant… plus intéressant que l’œuvre elle-même…
Édouard espérait confusément qu’on lui demanderait de lire ces notes. Mais aucun des trois autres ne manifesta la moindre curiosité. Au lieu de cela:
« Mon pauvre ami, dit Laura avec un accent de tristesse; ce roman, je vois bien que jamais vous ne l’écrirez.
– Eh bien! je vais vous dire une chose, s’écria dans un élan impétueux Édouard: ça m’est égal. Oui, si je ne parviens pas à l’écrire, ce livre, c’est que l’histoire du livre m’aura plus intéressé que le livre lui-même; qu’elle aura pris sa place; et ce sera tant mieux.
– Ne craignez-vous pas, en quittant la réalité, de vous égarer dans des régions mortellement abstraites et de faire un roman, non d’êtres vivants, mais d’idées? demanda Sophroniska craintivement.
– Et quand cela serait! cria Édouard avec un redoublement de vigueur. À cause des maladroits qui s’y sont fourvoyés, devons-nous condamner le roman d’idées? En guise de romans d’idées, on ne nous a servi jusqu’à présent que d’exécrables romans à thèses. Mais il ne s’agit pas de cela, vous pensez bien. Les idées…, les idées, je vous l’avoue, m’intéressent plus que les hommes; m’intéressent par-dessus tout. Elles vivent; elles combattent; elles agonisent comme les hommes. Naturellement on peut dire que nous ne les connaissons que par les hommes, de même que nous n’avons connaissance du vent que par les roseaux qu’il incline; mais tout de même le vent importe plus que les roseaux.
– Le vent existe indépendamment des roseaux », hasarda Bernard.
Son intervention fit rebondir Édouard, qui l’attendait depuis longtemps.
« Oui, je sais: les idées n’existent que par les hommes; mais, c’est bien là le pathétique: elles vivent aux dépens d’eux. »
Bernard avait écouté tout cela avec une attention soutenue; il avait plein de scepticisme et peu s’en fallait qu’Édouard ne lui parût un songe-creux; dans les derniers instants pourtant, l’éloquence de celui-ci l’avait ému; sous le souffle de cette éloquence, il avait senti s’incliner sa pensée; mais, se disait Bernard, comme un roseau après que le vent a passé, celle-ci bientôt se redresse. Il se remémorait ce qu’on leur enseignait en classe: les passions mènent l’homme, non les idées. Cependant Édouard continuait:
« Ce que je voudrais faire, comprenez-moi, c’est quelque chose qui serait comme l’Art de la fugue. Et je ne vois pas pourquoi ce qui fut possible en musique serait impossible en littérature… »
À quoi Sophroniska ripostait que la musique est un art mathématique, et qu’au surplus, à n’en considérer exceptionnellement plus que le chiffre, à en bannir le pathos et l’humanité, Bach avait réussi le chef-d’œuvre abstrait de l’ennui, une sorte de temple astronomique, où ne pouvaient pénétrer que de rares initiés. Édouard protestait aussitôt, qu’il trouvait ce temple admirable, qu’il y voyait l’aboutissement et le sommet de toute la carrière de Bach.
« Après quoi, ajouta Laura, on a été guéri de la fugue pour longtemps. L’émotion humaine, ne trouvant plus à s’y loger, a cherché d’autres domiciles. »
La discussion se perdait en arguties. Bernard, qui jusqu’à ce moment avait gardé le silence, mais qui commençait à s’impatienter sur sa chaise, à la fin n’y tint plus; avec une déférence extrême, exagérée même, comme chaque fois qu’il adressait la parole à Édouard, mais avec cette sorte d’enjouement qui semblait faire de cette déférence un jeu:
« Pardonnez-moi, Monsieur, dit-il, de connaître le titre de votre livre, puisque c’est par une indiscrétion, mais sur laquelle vous avez bien voulu, je crois, passer l’éponge. Ce titre pourtant semblait annoncer une histoire…?
– Oh! dites-nous ce titre, dit Laura.
– Ma chère amie, si vous voulez… Mais je vous avertis qu’il est possible que j’en change. Je crains qu’il ne soit un peu trompeur… Tenez, dites-le-leur, Bernard.
– Vous permettez?… Les Faux-Monnayeurs, dit Bernard. Mais maintenant, à votre tour, dites-nous: ces faux-monnayeurs… qui sont-ils?
– Eh bien! je n’en sais rien », dit Édouard.
Bernard et Laura se regardèrent, puis regardèrent Sophroniska; on entendit un long soupir; je crois qu’il fut poussé par Laura.
À vrai dire, c’est à certains de ses confrères qu’Édouard pensait d’abord, en pensant aux faux-monnayeurs; et singulièrement au vicomte de Passavant. Mais l’attribution s’était bientôt considérablement élargie; suivant que le vent de l’esprit soufflait ou de Rome ou d’ailleurs, ses héros tour à tour devenaient prêtres ou francs-maçons. Son cerveau, s’il l’abandonnait à sa pente, chavirait vite dans l’abstrait, où il se vautrait tout à l’aise. Les idées de change, de dévalorisation, d’inflation, peu à peu envahissaient son livre, comme les théories du vêtement le Sartor Resartus de Carlyle – où elles usurpaient la place des personnages. Édouard ne pouvant parler de cela, se taisait de la manière la plus gauche, et son silence, qui semblait un aveu de disette, commençait à gêner beaucoup les trois autres.
« Vous est-il arrivé déjà de tenir entre les mains une pièce fausse? demanda-t-il enfin.
– Oui, dit Bernard; mais le “non” des deux femmes couvrit sa voix.
– Eh bien! imaginez une pièce d’or de dix francs qui soit fausse. Elle ne vaut en réalité que deux sous. Elle vaudra dix francs tant qu’on ne reconnaîtra pas qu’elle est fausse. Si donc je pars de cette idée que…
– Mais pourquoi partir d’une idée? interrompit Bernard impatienté. Si vous partiez d’un fait bien exposé, l’idée viendrait l’habiter d’elle-même. Si j’écrivais Les Faux-Monnayeurs, je commencerais par présenter la pièce fausse, cette petite pièce dont vous parliez à l’instant… et que voici. »
Ce disant, il saisit dans son gousset une petite pièce de dix francs, qu’il jeta sur la table.
« Écoutez comme elle sonne bien. Presque le même son que les autres. On jurerait qu’elle est en or. J’y ai été pris ce matin, comme l’épicier qui me la passait y fut pris, m’a-t-il dit, lui-même. Elle n’a pas tout à fait le poids, je crois; mais elle a l’éclat et presque le son d’une vraie pièce; son revêtement est en or, de sorte qu’elle vaut pourtant un peu plus de deux sous; mais elle est en cristal. À l’usage, elle va devenir transparente. Non, ne la frottez pas; vous me l’abîmeriez. Déjà l’on voit presque au travers. »
Édouard l’avait saisie et la considérait avec la plus attentive curiosité.
« Mais de qui l’épicier la tient-il?
– Il ne sait plus. Il croit qu’il l’a depuis plusieurs jours dans son tiroir. Il s’amusait à me la passer, pour voir si j’y serais pris. J’allais l’accepter, ma parole! mais, comme il est honnête, il m’a détrompé; puis me l’a laissée pour cinq francs. Il voulait la garder pour la montrer à ce qu’il appelle “les amateurs”. J’ai pensé qu’il ne saurait y en avoir de meilleur que l’auteur des Faux-Monnayeurs; et c’est pour vous la montrer que je l’ai prise. Mais maintenant que vous l’avez examinée, rendez-la-moi! Je vois, hélas! que la réalité ne vous intéresse pas.
– Si, dit Édouard; mais elle me gêne.
– C’est dommage », reprit Bernard.
JOURNAL D’ÉDOUARD
Ce même soir.
« Sophroniska, Bernard et Laura m’ont questionné sur mon roman. Pourquoi me suis-je laissé aller à parler? Je n’ai dit que des âneries. Interrompu heureusement par le retour des deux enfants; rouges, essoufflés, comme s’ils avaient beaucoup couru. Sitôt entrée, Bronja s’est précipitée sur sa mère; j’ai cru qu’elle allait sangloter.
« “Maman, s’écria-t-elle, gronde un peu Boris. Il voulait se coucher tout nu dans la neige.”
« Sophroniska a regardé Boris qui se tenait sur le pas de la porte, le front bas et avec un regard fixe qui semblait presque haineux; elle a semblé ne pas s’apercevoir de l’expression insolite de cet enfant, mais avec un calme admirable:
« “Écoute, Boris, a-t-elle dit, il ne faut pas faire cela le soir. Si tu veux, nous irons là-bas demain matin; et, d’abord, tu essaieras d’y aller nu-pieds…”
« Elle caressait doucement le front de sa fille; mais celle-ci, brusquement, est tombée à terre et s’est roulée dans des convulsions. Nous étions assez inquiets. Sophroniska l’a prise et l’a étendue sur le sofa. Boris, sans bouger, regardait avec de grands yeux hébétés cette scène.
« Je crois les méthodes d’éducation de Sophroniska excellentes en théorie, mais peut-être s’abuse-t-elle sur la résistance de ces enfants.
« “Vous agissez comme si le bien devait toujours triompher du mal, lui ai-je dit un peu plus tard, quand je me suis trouvé seul avec elle. (Après le repas, j’étais allé demander des nouvelles de Bronja qui n’avait pu descendre dîner.)
« – En effet, m’a-t-elle dit. Je crois fermement que le bien doit triompher. J’ai confiance.
« – Pourtant, par excès de confiance, vous pouvez vous tromper…
« – Chaque fois que je me suis trompée, c’est que ma confiance n’a pas été assez forte. Aujourd’hui, en laissant sortir ces enfants, je m’étais laissée aller à leur montrer un peu d’inquiétude; ils l’ont sentie. Tout le reste est venu de là.”
« Elle m’a pris la main:
« “Vous n’avez pas l’air de croire à la vertu des convictions… je veux dire: à leur force agissante.
« – En effet, ai-je dit en riant, je ne suis pas mystique.
« – Eh bien! moi, s’est-elle écriée, dans un élan admirable, je crois de toute mon âme que, sans mysticisme, il ne se fait ici-bas rien de grand, rien de beau.”
« Découvert sur le registre des voyageurs le nom de Victor Strouvilhou. D’après les renseignements du patron de l’hôtel, il a dû quitter Saas-Fée l’avant-veille de notre arrivée, après être resté ici près d’un mois. J’aurais été curieux de le revoir. Sophroniska l’a sans doute fréquenté. Il faudra que je l’interroge. »
IV
« Je voulais vous demander, Laura, dit Bernard: pensez-vous qu’il y ait rien, sur cette terre, qui ne puisse être mis en doute?… C’est au point que je doute si l’on ne pourrait prendre le doute même comme point d’appui; car enfin, lui du moins je pense, ne nous fera jamais défaut. Je puis douter de la réalité de tout, mais pas de la réalité de mon doute. Je voudrais… Excusez-moi si je m’exprime d’une manière pédante; je ne suis pas pédant de ma nature, mais je sors de philosophie, et vous ne sauriez croire le pli que la dissertation fréquente imprime bientôt à l’esprit; je m’en corrigerai, je vous jure.
– Pourquoi cette parenthèse? Vous voudriez…?
– Je voudrais écrire l’histoire de quelqu’un qui d’abord écoute chacun, et qui va, consultant chacun, à la manière de Panurge, avant de décider quoi que ce soit; après avoir éprouvé que les opinions des uns et des autres, sur chaque point, se contredisent, il prendrait le parti de n’écouter plus rien que lui, et du coup deviendrait très fort.
– C’est un projet de vieillard, dit Laura.
– Je suis plus mûr que vous ne croyez. Depuis quelques jours, je tiens un carnet, comme Édouard; sur la page de droite j’écris une opinion, dès que, sur la page de gauche, en regard, je peux inscrire l’opinion contraire. Tenez, par exemple, l’autre soir, Sophroniska nous a dit qu’elle faisait dormir Boris et Bronja avec la fenêtre grande ouverte. Tout ce qu’elle nous a dit à l’appui de ce régime nous paraissait, n’est-il pas vrai, parfaitement raisonnable et probant. Mais voici qu’hier, au fumoir de l’hôtel, j’ai entendu ce professeur allemand qui vient d’arriver, soutenir une théorie opposée, qui m’a paru, je l’avoue, plus raisonnable encore et mieux fondée. L’important, disait-il, c’est, durant le sommeil, de restreindre le plus possible les dépenses et ce trafic d’échanges qu’est la vie; ce qu’il appelait la carburation; c’est alors seulement que le sommeil devient vraiment réparateur. Il donnait en exemple les oiseaux qui se mettent la tête sous l’aile, tous les animaux qui se blottissent pour dormir, de manière à ne respirer plus qu’à peine; ainsi les races les plus proches de la nature, disait-il, les paysans les moins cultivés se calfeutrent dans des alcôves; les Arabes, forcés de coucher en plein air, du moins ramènent sur leur visage le capuchon de leur burnous. Mais, revenant à Sophroniska et aux deux enfants qu’elle éduque, j’en viens à penser qu’elle n’a tout de même pas tort, et que ce qui est bon pour d’autres serait préjudiciable à ces petits, car, si j’ai bien compris, ils ont en eux des germes de tuberculose. Bref, je me dis… Mais je vous ennuie.
– Ne vous inquiétez donc pas de cela. Vous vous disiez?…
– Je ne sais plus.
– Allons! le voilà qui boude. N’ayez point honte de vos pensées.
– Je me disais que rien n’est bon pour tous, mais seulement par rapport à certains; que rien n’est vrai pour tous, mais seulement par rapport à qui le croit tel; qu’il n’est méthode ni théorie qui soit applicable indifféremment à chacun; que si, pour agir, il nous faut choisir, du moins nous avons libre choix; que si nous n’avons pas libre choix, la chose est plus simple encore; mais que ceci me devient vrai (non d’une manière absolue sans doute, mais par rapport à moi) qui me permet le meilleur emploi de mes forces, la mise en œuvre de mes vertus. Car tout à la fois je ne puis retenir mon doute, et j’ai l’indécision en horreur. Le “mol et doux oreiller” de Montaigne, n’est pas fait pour ma tête, car je n’ai pas sommeil encore et ne veux pas me reposer. La route est longue, qui mène de ce que je croyais être à ce que peut-être je suis. J’ai peur parfois de m’être levé trop matin.
– Vous avez peur?
– Non, je n’ai peur de rien. Mais savez-vous que j’ai déjà beaucoup changé; ou du moins mon paysage intérieur n’est déjà plus du tout le même que le jour où j’ai quitté la maison; depuis, je vous ai rencontrée. Tout aussitôt, j’ai cessé de chercher par-dessus tout ma liberté. Peut-être n’avez-vous pas bien compris que je suis à votre service.
– Que faut-il entendre par là?
– Oh! vous le savez bien. Pourquoi voulez-vous me le faire dire? Attendez-vous de moi des aveux?… Non, non, je vous en prie, ne voilez pas votre sourire, ou je prends froid.
– Voyons, mon petit Bernard, vous n’allez pourtant pas prétendre que vous commencez à m’aimer.
– Oh! je ne commence pas, dit Bernard. C’est vous qui commencez à le sentir, peut-être; mais vous ne pouvez pas m’empêcher.
– Ce m’était si charmant de n’avoir pas à me méfier de vous. Si maintenant je ne dois plus vous approcher qu’avec précaution, comme une matière inflammable… Mais songez à la créature difforme et gonflée que bientôt je vais être. Mon seul aspect saura bien vous guérir.
– Oui, si je n’aimais de vous que l’aspect. Et puis d’abord, je ne suis pas malade; ou si c’est être malade que de vous aimer, je préfère ne pas guérir. »
Il disait tout cela gravement, tristement presque; il la regardait plus tendrement que n’avaient jamais fait Édouard ni Douviers, mais si respectueusement qu’elle n’en pouvait point prendre ombrage. Elle tenait sur ses genoux un livre anglais dont ils avaient interrompu la lecture, et qu’elle feuilletait distraitement; on eût dit qu’elle n’écoutait point, de sorte que Bernard continuait sans trop de gêne:
« J’imaginais l’amour comme quelque chose de volcanique; du moins celui que j’étais né pour éprouver. Oui, vraiment je croyais ne pouvoir aimer que d’une manière sauvage, dévastatrice, à la Byron. Comme je me connaissais mal! C’est vous, Laura, qui m’avez fait me connaître; si différent de celui que je croyais que j’étais! Je jouais un affreux personnage, m’efforçais de lui ressembler. Quand je songe à la lettre que j’écrivais à mon faux père avant de quitter la maison, j’ai grand-honte, je vous assure. Je me prenais pour un révolté, un outlaw, qui foule aux pieds tout ce qui fait obstacle à son désir; et voici que, près de vous, je n’ai même plus de désirs. J’aspirais à la liberté comme à un bien suprême, et je n’ai pas plus tôt été libre que je me suis soumis à vos… Ah! si vous saviez ce que c’est enrageant d’avoir dans la tête des tas de phrases de grands auteurs, qui viennent irrésistiblement sur vos lèvres quand on veut exprimer un sentiment sincère. Ce sentiment est si nouveau pour moi qu’il n’a pas encore su inventer son langage. Mettons que ce ne soit pas de l’amour, puisque ce mot-là vous déplaît; que ce soit de la dévotion. On dirait qu’à cette liberté, qui me paraissait jusqu’alors infinie, vos lois ont tracé des limites. On dirait que tout ce qui s’agitait en moi de turbulent, d’informe, danse une ronde harmonieuse autour de vous. Si quelqu’une de mes pensées vient à s’écarter de vous, je la quitte… Laura, je ne vous demande pas de m’aimer; je ne suis rien encore qu’un écolier; je ne vaux pas votre attention; mais tout ce que je veux faire à présent, c’est pour mériter un peu votre… (ah! le mot est hideux…) votre estime. »
Il s’était mis à genoux devant elle, et bien qu’elle eût un peu reculé sa chaise d’abord, Bernard touchait du front sa robe, les bras rejetés en arrière comme en signe d’adoration; mais quand il sentit sur son front la main de Laura se poser, il saisit cette main sur laquelle il pressa ses lèvres.
« Quel enfant vous êtes, Bernard! Moi non plus je ne suis pas libre, dit-elle en retirant sa main. Tenez, lisez ceci. »
Elle sortit de son corsage un papier froissé qu’elle tendit à Bernard.
Bernard vit d’abord la signature. Ainsi qu’il le craignait, c’était celle de Félix Douviers. Un instant il garda la lettre dans sa main sans la lire; il levait les yeux vers Laura. Elle pleurait. Bernard sentit alors en son cœur encore une attache se rompre, un de ces liens secrets qui relient chacun de nous à soi-même, à son égoïste passé. Puis il lut:
« Ma Laura bien-aimée,
« Au nom de ce petit enfant qui va naître, et que je fais serment d’aimer autant que si j’étais son père, je te conjure de revenir. Ne crois pas qu’aucun reproche puisse accueillir ici ton retour. Ne t’accuse pas trop, car c’est de cela surtout que je souffre. Ne tarde pas. Je t’attends de toute mon âme qui t’adore et se prosterne devant toi. »
Bernard était assis à terre, devant Laura, mais c’est sans la regarder qu’il lui demanda:
« Quand avez-vous reçu cette lettre?
– Ce matin.
– Je croyais qu’il ignorait tout. Vous lui avez écrit?
– Oui; je lui ai tout avoué.
– Édouard le sait-il?
– Il n’en sait rien. »
Bernard resta silencieux quelque temps, la tête basse; puis, retourné vers elle de nouveau:
« Et… que comptez-vous faire à présent?
– Me le demandez-vous vraiment?… Retourner près de lui. C’est à côté de lui qu’est ma place. C’est avec lui que je dois vivre. Vous le savez.
– Oui », dit Bernard.
Il y eut un très long silence. Bernard reprit:
« Est-ce que vous croyez qu’on peut aimer l’enfant d’un autre autant que le sien propre, vraiment?
– Je ne sais pas si je le crois; mais je l’espère.
– Pour moi, je le crois. Et je ne crois pas, au contraire, à ce qu’on appelle si bêtement “la voix du sang”. Oui, je crois que cette fameuse voix n’est qu’un mythe. J’ai lu que, chez certaines peuplades des îles de l’Océanie, c’est la coutume d’adopter les enfants d’autrui, et que ces enfants adoptés sont souvent préférés aux autres. Le livre disait, je m’en souviens fort bien, “plus choyés”. Savez-vous ce que je pense à présent?… Je pense que celui qui m’a tenu lieu de père n’a jamais rien dit ni rien fait qui laissât soupçonner que je n’étais pas son vrai fils; qu’en lui écrivant, comme j’ai fait, que j’avais toujours senti la différence, j’ai menti; qu’au contraire il me témoignait une sorte de prédilection, à laquelle j’étais sensible; de sorte que mon ingratitude envers lui est d’autant plus abominable; que j’ai mal agi envers lui. Laura, mon amie, je voudrais vous demander… Est-ce que vous trouvez que je devrais implorer son pardon, retourner près de lui?
– Non, dit Laura.
– Pourquoi? Si vous, vous retournez près de Douviers…
– Vous me le disiez tout à l’heure, ce qui est vrai pour l’un ne l’est pas pour un autre. Je me sens faible; vous êtes fort. Monsieur Profitendieu peut vous aimer; mais, si j’en crois ce que vous m’avez dit de lui, vous n’êtes pas faits pour vous entendre… Ou du moins, attendez encore. Ne revenez pas à lui défait. Voulez-vous toute ma pensée? C’est pour moi, non pour lui, que vous vous proposez cela; pour obtenir ce que vous appeliez: mon estime. Vous ne l’aurez, Bernard, que si je ne vous sens pas la chercher. Je ne peux vous aimer que naturel. Laissez-moi le repentir; il n’est pas fait pour vous, Bernard.
– J’en viens presque à aimer mon nom, quand je l’entends sur votre bouche. Savez-vous ce dont j’avais le plus horreur, là-bas? C’est du luxe. Tant de confort, tant de facilités… Je me sentais devenir anarchiste. À présent, au contraire, je crois que je tourne au conservateur. J’ai compris brusquement cela, l’autre jour, à cette indignation qui m’a pris en entendant le touriste de la frontière parler du plaisir qu’il avait à frauder la douane. “Voler l’État, c’est ne voler personne”, disait-il. Par protestation, j’ai compris tout à coup ce que c’était que l’État. Et je me suis mis à l’aimer, simplement parce qu’on lui faisait du tort. Je n’avais jamais réfléchi à cela. “L’État, ce n’est qu’une convention”, disait-il encore. Quelle belle chose ce serait, une convention qui reposerait sur la bonne foi de chacun… si seulement il n’y avait que des gens probes. Tenez, on me demanderait aujourd’hui quelle vertu me paraît la plus belle, je répondrais sans hésiter: la probité. Oh! Laura! Je voudrais, tout le long de ma vie, au moindre choc, rendre un son pur, probe, authentique. Presque tous les gens que j’ai connus sonnent faux. Valoir exactement ce qu’on paraît; ne pas chercher à paraître plus qu’on ne vaut… On veut donner le change, et l’on s’occupe tant de paraître, qu’on finit par ne plus savoir qui l’on est… Excusez-moi de vous parler ainsi. Je vous fais part de mes réflexions de la nuit.
– Vous pensiez à la petite pièce que vous nous montriez hier. Lorsque je partirai… »
Elle ne put achever sa phrase; les larmes montaient à ses yeux, et, dans l’effort qu’elle fit pour les retenir, Bernard vit ses lèvres trembler.
« Alors, vous partiez, Laura… reprit-il tristement. J’ai peur, lorsque je ne vous sentirai plus près de moi, de ne plus rien valoir, ou que si peu… Mais, dites, je voudrais vous demander:… est-ce que vous partiriez, auriez-vous écrit ces aveux, si Édouard… je ne sais comment dire… (et tandis que Laura rougissait) si Édouard valait davantage? Oh! ne protestez pas. Je sais si bien ce que vous pensez de lui.
– Vous dites cela parce que hier vous avez surpris mon sourire, tandis qu’il parlait; vous vous êtes aussitôt persuadé que nous le jugions pareillement. Mais non; détrompez-vous. À vrai dire, je ne sais pas ce que je pense de lui. Il n’est jamais longtemps le même. Il ne s’attache à rien; mais rien n’est plus attachant que sa fuite. Vous le connaissez depuis trop peu de temps pour le juger. Son être se défait et se refait sans cesse. On croit le saisir… c’est Protée. Il prend la forme de ce qu’il aime. Et lui-même, pour le comprendre, il faut l’aimer.
– Vous l’aimez. Oh! Laura, ce n’est pas de Douviers que je me sens jaloux, ni de Vincent; c’est d’Édouard.
– Pourquoi jaloux? J’aime Douviers; j’aime Édouard; mais différemment. Si je dois vous aimer, ce sera d’un autre amour encore.
– Laura, Laura, vous n’aimez pas Douviers. Vous avez pour lui de l’affection, de la pitié, de l’estime: mais cela n’est pas de l’amour. Je crois que le secret de votre tristesse (car vous êtes triste, Laura) c’est que la vie vous a divisée; l’amour n’a voulu de vous qu’incomplète; vous répartissez sur plusieurs ce que vous auriez voulu donner à un seul. Pour moi, je me sens indivisible; je ne puis me donner qu’en entier.
– Vous êtes trop jeune pour parler ainsi. Vous ne pouvez savoir déjà, si, vous aussi, la vie ne vous “divisera” pas, comme vous dites. Je ne puis accepter de vous que cette… dévotion, que vous m’offrez. Le reste aura ses exigences, qui devront bien se satisfaire ailleurs.
– Serait-il vrai? Vous allez me dégoûter par avance et de moi-même et de la vie.
– Vous ne connaissez rien de la vie. Vous pouvez tout attendre d’elle. Savez-vous quelle a été ma faute? De ne plus en attendre rien. C’est quand j’ai cru, hélas! que je n’avais plus rien à attendre, que je me suis abandonnée. J’ai vécu ce printemps, à Pau, comme si je ne devais plus en voir d’autres; comme si plus rien n’importait. Bernard, je puis vous le dire, à présent que j’en suis punie: ne désespérez jamais de la vie. »
Que sert de parler ainsi à un jeune être plein de flamme? Aussi bien ce que disait Laura ne s’adressait point à Bernard. À l’appel de sa sympathie, elle pensait devant lui, malgré elle, à voix haute. Elle était inhabile à feindre, inhabile à se maîtriser. Comme elle avait cédé d’abord à cet élan qui l’emportait dès qu’elle pensait à Édouard, et où se trahissait son amour, elle s’était laissée aller à certain besoin de sermonner qu’elle tenait assurément de son père. Mais Bernard avait horreur des recommandations, des conseils, dussent-ils venir de Laura; son sourire avertit Laura, qui reprit sur un ton plus calme:
« Pensez-vous demeurer le secrétaire d’Édouard, à votre retour à Paris?
– Oui, s’il consent à m’employer; mais il ne me donne rien à faire. Savez-vous ce qui m’amuserait? C’est d’écrire avec lui ce livre, que, seul, il n’écrira jamais; vous le lui avez bien dit hier. Je trouve absurde cette méthode de travail qu’il nous exposait. Un bon roman s’écrit plus naïvement que cela. Et d’abord, il faut croire à ce que l’on raconte, ne pensez-vous pas? et raconter tout simplement. J’ai d’abord cru que je pourrais l’aider. S’il avait eu besoin d’un détective, j’aurais peut-être satisfait aux exigences de l’emploi, il aurait travaillé sur les faits qu’aurait découverts ma police… Mais avec un idéologue, rien à faire. Près de lui, je me sens une âme de reporter. S’il s’entête dans son erreur, je travaillerai de mon côté. Il me faudra gagner ma vie. J’offrirai mes services à quelque journal. Entre-temps, je ferai des vers.
– Car près des reporters, assurément, vous vous sentirez une âme de poète.
– Oh! ne vous moquez pas de moi. Je sais que je suis ridicule; ne me le faites pas trop sentir.
– Restez avec Édouard; vous l’aiderez, et laissez-vous aider par lui. Il est bon.
On entendit la cloche du déjeuner. Bernard se leva. Laura lui prit la main:
– Dites encore: cette petite pièce que vous nous montriez hier… en souvenir de vous, lorsque je partirai – elle se raidit et cette fois put achever sa phrase – voudriez-vous me la donner?
– Tenez; la voici; prenez-la », dit Bernard.
V
JOURNAL D’ÉDOUARD
C’est ce qui arrive de presque toutes les maladies de l’esprit humain qu’on se flatte d’avoir guéries. On les répercute seulement, comme on dit en médecine, et on leur en substitue d’autres.
Sainte-Beuve (Lundis, I, p. 19).
« Je commence à entrevoir ce que j’appellerais le “sujet profond” de mon livre. C’est, ce sera sans doute la rivalité du monde réel et de la représentation que nous nous en faisons. La manière dont le monde des apparences s’impose à nous et dont nous tentons d’imposer au monde extérieur notre interprétation particulière, fait le drame de notre vie. La résistance des faits nous invite à transporter notre construction idéale dans le rêve, l’espérance, la vie future, en laquelle notre croyance s’alimente de tous nos déboires dans celle-ci. Les réalistes partent des faits, accommodent aux faits leurs idées. Bernard est un réaliste. Je crains de ne pouvoir m’entendre avec lui.
« Comment ai-je pu acquiescer lorsque Sophroniska m’a dit que je n’avais rien d’un mystique? Je suis tout prêt à reconnaître avec elle que, sans mysticisme, l’homme ne peut réussir rien de grand. Mais n’est-ce pas précisément mon mysticisme qu’incrimine Laura lorsque je lui parle de mon livre?… Abandonnons-leur ce débat.
« Sophroniska m’a reparlé de Boris, qu’elle est parvenue, croit-elle, à confesser entièrement. Le pauvre enfant n’a plus en lui le moindre taillis, la moindre touffe où s’abriter des regards de la doctoresse. Il est tout débusqué. Sophroniska étale au grand jour, démontés, les rouages les plus intimes de son organisme mental, comme un horloger les pièces de la pendule qu’il nettoie. Si, après cela, le petit ne sonne pas à l’heure, c’est à y perdre son latin. Voici ce que Sophroniska m’a raconté:
« Boris, vers l’âge de neuf ans, a été mis au collège, à Varsovie. Il s’est lié avec un camarade de classe, un certain Baptistin Kraft, d’un ou deux ans plus âgé que lui, qui l’a initié à des pratiques clandestines, que ces enfants naïvement émerveillés, croyaient être “de la magie”. C’est le nom qu’ils donnaient à leur vice, pour avoir entendu dire, ou lu, que la magie permet d’entrer mystérieusement en possession de ce que l’on désire, qu’elle illimite la puissance, etc. Ils croyaient de bonne foi avoir découvert un secret qui consolât de l’absence réelle par la présence illusoire, et s’hallucinaient à plaisir et s’extasiaient sur un vide que leur imagination surmenée bondait de merveilles, à grand renfort de volupté. Il va sans dire que Sophroniska ne s’est pas servie de ces termes; j’aurais voulu qu’elle me rapportât exactement ceux de Boris, mais elle prétend qu’elle n’est parvenue à démêler ce que dessus, dont elle m’a pourtant certifié l’exactitude, qu’à travers un fouillis de feintes, de réticences et d’imprécisions.
« J’ai trouvé là l’explication que je cherchais depuis longtemps, a-t-elle ajouté, d’un bout de parchemin que Boris gardait toujours sur lui, enfermé dans un sachet qui pendait sur sa poitrine à côté des médailles de sainteté que sa mère le force à porter – et sur lequel étaient cinq mots, en caractères majuscules, enfantins et soignés, cinq mots dont je lui demandais en vain la signification: GAZ. TÉLÉPHONE. CENT MILLE ROUBLES.
« “Mais ça ne veut rien dire. C’est de la magie”, me répondait-il toujours quand je le pressais. C’est tout ce que je pouvais obtenir. Je sais à présent que ces mots énigmatiques sont de l’écriture du jeune Baptistin, grand maître et professeur de magie, et qu’ils étaient pour ces enfants, ces cinq mots, comme une formule incantatoire, le “Sésame ouvre-toi” du paradis honteux où la volupté les plongeait. Boris appelait ce parchemin: son talisman. J’avais eu déjà beaucoup de mal à le décider à me le montrer, et plus encore à s’en défaire (c’était au début de notre séjour ici); car je voulais qu’il s’en défît, comme je sais à présent qu’il s’était déjà précédemment libéré de ses mauvaises habitudes. J’avais l’espoir qu’avec ce talisman allaient disparaître les tics et les manies dont il souffre. Mais il s’y raccrochait, et la maladie s’y raccrochait comme à un dernier refuge.
« “Vous dites pourtant qu’il s’était délivré de ses habitudes…
« – La maladie nerveuse n’a commencé qu’ensuite. Elle est née sans aucun doute de la contrainte que Boris a dû exercer sur lui-même pour se libérer. J’ai su par lui que sa mère l’avait surpris un jour en train de « faire de la magie » comme il dit. Pourquoi ne m’a-t-elle jamais parlé de cela?… Par pudeur?…
« – Et sans doute parce qu’elle le savait corrigé.
« – C’est absurde… et cela est cause que j’ai tâtonné si longtemps. Je vous ai dit que je croyais Boris parfaitement pur.
« – Vous m’avez même dit que c’était cela qui vous gênait.
« – Vous voyez si j’avais raison!… La mère aurait dû m’avertir. Boris serait déjà guéri, si j’avais pu aussitôt y voir clair.
« – Vous disiez que ces malaises n’ont commencé qu’ensuite…
« – Je dis qu’ils sont nés par protestation. Sa mère l’a grondé, supplié, sermonné, j’imagine. La mort du père est survenue. Boris s’est persuadé que ses pratiques secrètes, qu’on lui peignait comme si coupables, avaient reçu leur châtiment; il s’est tenu pour responsable de la mort de son père; il s’est cru criminel, damné. Il a pris peur; et c’est alors que, comme un animal traqué, son organisme débile a inventé cette quantité de petits subterfuges où se purge sa peine intime et qui sont comme autant d’aveux.
« – Si je vous comprends bien, vous estimez qu’il eût été moins préjudiciable pour Boris de continuer à se livrer tranquillement à la pratique de sa “magie”?
« – Je crois qu’il n’était pas nécessaire, pour l’en guérir, de l’effrayer. Le changement de vie, qu’entraînait la mort de son père, eût suffi sans doute à l’en distraire, et le départ de Varsovie à le soustraire à l’influence de son ami. On n’obtient rien de bon par l’épouvante. Quand j’ai su ce qui en était, lui reparlant de tout cela et revenant sur le passé, je lui ai fait honte d’avoir pu préférer la possession de biens imaginaires à celle des biens véritables, qui sont, lui ai-je dit, la récompense d’un effort. Loin de chercher à noircir son vice, je le lui ai représenté simplement comme une des formes de la paresse; et je crois en effet que c’en est une; la plus subtile, la plus perfide…”
« Je me souvins, à ces mots, de quelques lignes de La Rochefoucauld, que je voulus lui montrer, et, bien que j’eusse pu les lui citer de mémoire, j’allai chercher le petit livre des Maximes, sans lequel je ne voyage jamais. Je lui lus:
« “De toutes les passions, celle qui est la plus inconnue à nous-mêmes, c’est la paresse; elle est la plus ardente et la plus maligne de toutes, quoique sa violence soit insensible et que les dommages qu’elle cause soient très cachés… Le repos de la paresse est un charme secret de l’âme qui suspend soudainement les plus ardentes poursuites et les plus opiniâtres résolutions. Pour donner enfin la véritable idée de cette passion, il faut dire que la paresse est comme une béatitude de l’âme, qui la console de toutes ses pertes et qui lui tient lieu de tous les biens.”
« “Prétendez-vous, me dit alors Sophroniska, que La Rochefoucauld, en écrivant ceci, ait voulu insinuer ce que nous disions?
« – Il se peut; mais je ne le crois pas. Nos auteurs classiques sont riches de toutes les interprétations qu’ils permettent. Leur précision est d’autant plus admirable qu’elle ne se prétend pas exclusive.”
« Je lui ai demandé de me montrer ce fameux talisman de Boris. Elle m’a dit qu’elle ne l’avait plus, qu’elle l’avait donné à quelqu’un qui s’intéressait à Boris et qui lui avait demandé de le lui laisser en souvenir. – “Un certain M. Strouvilhou, que j’ai rencontré ici quelque temps avant votre arrivée.”
« J’ai dit à Sophroniska que j’avais vu ce nom sur le registre de l’hôtel; que j’avais connu dans le temps un Strouvilhou, et que j’aurais été curieux de savoir si c’était le même. À la description qu’elle m’a faite de lui on ne pouvait pas s’y tromper; mais elle n’a rien su me dire à son sujet qui satisfît ma curiosité. J’ai su seulement qu’il était très aimable, très empressé, qu’il lui paraissait fort intelligent mais un peu paresseux lui-même, “si j’ose encore employer ce mot”, a-t-elle ajouté en riant. Je lui ai raconté à mon tour ce que je savais de Strouvilhou, et cela m’a amené à lui parler de la pension où nous nous étions rencontrés, des parents de Laura (qui de son côté lui avait fait ses confidences), du vieux La Pérouse enfin, des liens de parenté qui l’attachaient au petit Boris, et de la promesse que je lui avais faite en le quittant de lui amener cet enfant. Comme Sophroniska m’avait dit précédemment qu’elle ne croyait pas souhaitable que Boris continuât à vivre avec sa mère: “Que ne le mettez-vous en pension chez les Azaïs?” ai-je demandé. En lui suggérant cela, je songeais surtout à l’immense joie du grand-père à savoir Boris tout près de lui, chez des amis, où il pourrait le voir à son gré; mais je ne puis croire que, de son côté, le petit n’y soit bien. Sophroniska m’a dit qu’elle allait y réfléchir; au demeurant, extrêmement intéressée par tout ce que je venais de lui apprendre.
« Sophroniska va répétant que le petit Boris est guéri; cette cure doit corroborer sa méthode; mais je crains qu’elle n’anticipe un peu. Naturellement je ne veux pas la contredire; et je reconnais que les tics, les gestes-repentirs, les réticences du langage, ont à peu près disparu; mais il me semble que la maladie s’est simplement réfugiée dans une région plus profonde de l’être, comme pour échapper au regard inquisiteur du médecin; et que c’est à présent l’âme même qui est atteinte. De même qu’à l’onanisme avaient succédé les mouvements nerveux, ceux-ci cèdent à présent à je ne sais quelle transe invisible. Sophroniska s’inquiète, il est vrai, de voir Boris, à la suite de Bronja, précipité dans une sorte de mysticisme puéril; elle est trop intelligente pour ne comprendre point que cette nouvelle “béatitude de l’âme” que recherche à présent Boris, n’est pas très différente après tout, de celle qu’il provoquait d’abord par artifice, et que, pour être moins dispendieuse, moins ruineuse pour l’organisme, elle ne le détourne pas moins de l’effort et de la réalisation. Mais, lorsque je lui en parle, elle me répond que des âmes comme celles de Boris et de Bronja ne peuvent se passer d’un aliment chimérique et que, s’il leur était enlevé, elles succomberaient, Bronja dans le désespoir, et Boris dans un matérialisme vulgaire; elle estime, en outre, qu’elle n’a pas le droit d’abîmer la confiance de ces petits, et, bien que tenant leur croyance pour mensongère, elle veut y voir une sublimation des instincts bas, une postulation supérieure, une incitation, une préservation, que sais-je?… Sans croire elle-même aux dogmes de l’Église, elle croit à l’efficacité de la foi. Elle parle avec émotion de la piété de ces deux enfants, qui lisent ensemble l’Apocalypse, et s’exaltent, et conversent avec les anges et revêtent leur âme de suaires blancs. Comme toutes les femmes, elle est pleine de contradictions. Mais elle avait raison: je ne suis décidément pas un mystique… non plus qu’un paresseux. Je compte beaucoup sur l’atmosphère de la pension Azaïs et de Paris pour faire de Boris un travailleur; pour le guérir enfin de la recherche des “biens imaginaires”. C’est là, pour lui, qu’est le salut. Sophroniska se fait, je crois, à l’idée de me le confier; mais sans doute l’accompagnera-t-elle à Paris, désireuse de veiller elle-même à son installation chez les Azaïs, et, par là, de rassurer la mère, dont elle se fait fort de remporter l’assentiment. »
VI
D’OLIVIER À BERNARD
Il y a de certains défauts qui, bien mis en œuvre, brillent plus que la vertu même.
La Rochefoucauld.
« Cher vieux,
Que je te dise d’abord que j’ai bien passé mon bachot. Mais ceci n’a pas d’importance. Une occasion unique s’offrait à moi de partir en voyage. Je balançais encore; mais après lecture de ta lettre, j’ai sauté dessus. Une légère résistance de ma mère, d’abord; mais dont a vite triomphé Vincent, qui s’est montré d’une gentillesse que je n’espérais pas de lui. Je ne puis croire que, dans la circonstance à laquelle ta lettre fait allusion, il ait agi comme un mufle. Nous avons, à notre âge, une fâcheuse tendance à juger les gens trop sévèrement et à condamner sans appel. Bien des actes nous apparaissent répréhensibles, odieux même, simplement parce que nous n’en pénétrons pas suffisamment les motifs. Vincent n’a pas… Mais ceci m’entraînerait trop loin et j’ai trop de choses à te dire.
« Sache que c’est le rédacteur en chef de la nouvelle revue Avant-Garde, qui t’écrit. Après quelques délibérations, j’ai accepté d’assumer ces fonctions, dont le comte Robert de Passavant m’a jugé digne. C’est lui qui commandite la revue, mais il ne tient pas trop à ce qu’on le sache et, sur la couverture, c’est mon nom seul qui figurera. Nous commencerons à paraître en octobre; tâche de m’envoyer quelque chose pour le premier numéro; je serais désolé que ton nom ne brillât pas à côté du mien, dans le premier sommaire. Passavant voudrait que, dans le premier numéro, paraisse quelque chose de très libre et d’épicé, parce qu’il estime que le plus mortel reproche que puisse encourir une jeune revue, c’est d’être pudibonde; je suis assez de son avis. Nous en causons beaucoup. Il m’a demandé d’écrire cela et m’a fourni le sujet assez risqué d’une courte nouvelle; ça m’ennuie un peu à cause de ma mère, que cela risque de peiner; mais tant pis. Comme dit Passavant: plus on est jeune, moins le scandale est compromettant.
« C’est de Vizzavone que je t’écris. Vizzavone est un petit patelin à mi-flanc d’une des plus hautes montagnes de la Corse, enfoui dans une épaisse forêt. L’hôtel où nous habitons est assez loin du village et sert aux touristes comme point de départ pour des excursions. Il n’y a que quelques jours que nous y sommes. Nous avons commencé par nous installer dans une auberge, non loin de l’admirable baie de Porto, absolument déserte, où nous descendions nous baigner le matin et où l’on peut vivre à loisir tout le long du jour. C’était merveilleux; mais il faisait trop chaud et nous avons dû gagner la montagne.
« Passavant est un compagnon charmant; il n’est pas du tout entiché de son titre; il veut que je l’appelle Robert; et il a inventé de m’appeler: Olive. Dis, si ce n’est pas charmant? Il fait tout pour me faire oublier son âge et je t’assure qu’il y parvient. Ma mère était un peu effrayée de me voir partir avec lui, car elle le connaissait à peine. J’hésitais, par crainte de la chagriner. Avant ta lettre, j’avais même presque renoncé. Vincent l’a persuadée et ta lettre m’a brusquement donné du courage. Nous avons passé les derniers jours, avant le départ, à courir les magasins. Passavant est si généreux qu’il voulait toujours tout m’offrir et que je devais sans cesse l’arrêter. Mais il trouvait mes pauvres nippes affreuses: chemises, cravates, chaussettes, rien de ce que j’avais ne lui plaisait; il répétait que, si je devais vivre quelque temps avec lui, il souffrirait trop de ne pas me voir vêtu comme il faut – c’est-à-dire: comme il lui plaît. Naturellement, on faisait envoyer chez lui toutes les emplettes, par crainte d’inquiéter maman. Il est lui-même d’une élégance raffinée; mais surtout il a très bon goût, et beaucoup de choses qui me paraissaient supportables me sont devenues odieuses aujourd’hui. Tu n’imagines pas comme il pouvait être amusant chez les fournisseurs. Il est tellement spirituel! Je voudrais t’en donner une idée: nous nous trouvions chez Brentano, où il avait donné à réparer son stylo. Il y avait derrière lui un énorme Anglais qui voulait passer avant son tour, et qui, comme Robert le repoussait un peu brusquement, a commencé à baragouiner je ne sais quoi à son adresse; Robert s’est retourné et, très calme:
« “Ce n’est pas la peine. Je ne comprends pas l’anglais.”
« L’autre, furieux, a reparti, en pur français:
« “Vous devriez le savoir, Monsieur.”
« Alors Robert, en souriant très poliment:
« “Vous voyez bien que ce n’est pas la peine.”
« L’Anglais bouillonnait, mais n’a plus su que dire. C’était roulant.
« Un autre jour, nous étions à l’Olympia. Pendant l’entracte, nous nous promenions dans le hall où circulait grande abondance de putains. Deux d’entre elles, d’aspect plutôt minable, l’ont accosté:
« “Tu paies un bock, chéri?”
« Nous nous sommes assis avec elles, à une table.
« “Garçon! Un bock pour ces dames.
« – Et pour ces Messieurs?
« – Nous?… Oh! nous prendrons du champagne”, a-t-il dit tout négligemment. Et il a commandé une bouteille de moët, que nous avons sifflée à nous deux. Si tu avais vu la tête des pauvres filles!… Je crois qu’il a horreur des putains. Il m’a confié qu’il n’était jamais entré dans un bordel et m’a laissé entendre qu’il serait très fâché contre moi si j’y allais. Tu vois que c’est quelqu’un de très propre, malgré ses airs et ses propos cyniques – comme lorsqu’il dit qu’en voyage, il appelle « journée morne » celle où il n’a pas rencontré before lunch au moins cinq personnes avec qui désirer coucher. Je dois te dire entre parenthèses que je n’ai pas recommencé… – tu m’entends.
« Il a une façon de moraliser qui est tout à fait amusante et particulière. Il m’a dit l’autre jour:
« “Vois-tu, mon petit, l’important, dans la vie, c’est de ne pas se laisser entraîner. Une chose en amène une autre et puis on ne sait plus où l’on va. Ainsi, j’ai connu un jeune homme très bien qui devait épouser la fille de ma cuisinière. Une nuit, il est entré par hasard chez un petit bijoutier. Il l’a tué. Et après, il a volé. Et après, il a dissimulé. Tu vois où ça mène. La dernière fois que je l’ai revu, il était devenu menteur. Fais attention.”
« Et il est tout le temps comme ça. C’est te dire que je ne m’embête pas. Nous étions partis avec l’intention de travailler beaucoup, mais jusqu’à présent nous n’avons guère fait que nous baigner, nous laisser sécher au soleil et bavarder. Il a surtout des opinions et des idées extrêmement originales. Je le pousse tant que je peux à écrire certaines théories tout à fait neuves qu’il m’a exposées sur les animaux marins des bas-fonds et ce qu’il appelle les “lumières personnelles”, qui leur permet de se passer de la lumière du soleil, qu’il assimile à celle de la grâce et à la “révélation”. Exposé en quelques mots comme je fais, ça ne peut rien dire, mais je t’assure que, lorsqu’il en parle, c’est intéressant comme un roman. On ne sait pas, d’ordinaire, qu’il est très calé en histoire naturelle; mais il met une sorte de coquetterie à cacher ses connaissances. C’est ce qu’il appelle ses bijoux secrets. Il dit qu’il n’y a que les rastas qui se plaisent à étaler aux yeux de tous leur parure, et surtout quand celle-ci est en toc.
« Il sait admirablement se servir des idées, des images, des gens, des choses; c’est-à-dire qu’il met tout à profit. Il dit que le grand art de la vie, ce n’est pas tant de jouir que d’apprendre à tirer parti.
« J’ai écrit quelques vers, mais je n’en suis pas assez content pour te les envoyer.
« Au revoir, mon vieux. En octobre. Tu me trouveras changé, moi aussi. Je prends chaque jour un peu plus d’assurance. Je suis heureux de te savoir en Suisse, mais tu vois que je n’ai rien à t’envier.
« Olivier. »
Bernard tendit cette lettre à Édouard qui la lut sans laisser rien paraître des sentiments qu’elle agitait en lui. Tout ce qu’Olivier racontait si complaisamment de Robert l’indignait et achevait de le lui faire prendre en haine. Surtout il s’affectait de n’être même pas nommé dans cette lettre et qu’Olivier semblât l’oublier. Il fit de vains efforts pour déchiffrer, sous une épaisse rature, les trois lignes, écrites en post-scriptum, et que voici:
« Dis à l’oncle É… que je pense à lui constamment; que je ne puis pas lui pardonner de m’avoir plaqué et que j’en garde au cœur une blessure mortelle. »
Ces lignes étaient les seules sincères de cette lettre de parade, toute dictée par le dépit. Olivier les avait barrées.
Édouard avait rendu à Bernard l’affreuse lettre, sans souffler mot; sans souffler mot, Bernard l’avait reprise. J’ai dit qu’ils ne se parlaient pas beaucoup; une sorte de contrainte étrange, inexplicable, pesait sur eux aussitôt qu’ils se trouvaient seuls. (Je n’aime pas ce mot « inexplicable », et ne l’écris ici que par insuffisance provisoire.) Mais ce soir, retirés dans leur chambre, et tandis qu’ils s’apprêtaient pour la nuit, Bernard, dans un grand effort, et la gorge un peu contractée, demanda:
« Laura vous a montré la lettre qu’elle a reçue de Douviers?
– Je ne pouvais douter que Douviers ne prît la chose comme il faut, dit Édouard en se mettant au lit. C’est quelqu’un de très bien. Un peu faible peut-être; mais tout de même très bien. Il va adorer cet enfant, j’en suis sûr. Et le petit sera sûrement plus robuste qu’il n’aurait su le faire lui-même. Car il ne m’a pas l’air bien costaud. »
Bernard aimait Laura beaucoup trop pour n’être pas choqué par la désinvolture d’Édouard; il n’en laissa néanmoins rien paraître.
« Allons! reprit Édouard en éteignant sa bougie, je suis heureux de voir se terminer pour le mieux cette histoire, qui paraissait sans autre issue que le désespoir. Ça arrive à n’importe qui de faire un faux départ. L’important, c’est de ne pas s’entêter…
– Évidemment, dit Bernard pour éluder la discussion.
– Il faut bien que je vous avoue, Bernard, que je crains d’en avoir fait un avec vous…
– Un faux départ?
– Ma foi, oui. Malgré toute l’affection que j’ai pour vous, je me persuade depuis quelques jours que nous ne sommes pas faits pour nous entendre et que… (il hésita quelques instants, chercha ses mots), de m’accompagner plus longtemps vous fourvoie. »
Bernard pensait de même, aussi longtemps qu’Édouard n’avait pas parlé; mais Édouard ne pouvait certes rien dire de plus propre à ressaisir Bernard. L’instinct de contradiction l’emportant, celui-ci protesta.
« Vous ne me connaissez pas bien, et je ne me connais pas bien moi-même. Vous ne m’avez pas mis à l’épreuve. Si vous n’avez aucun grief contre moi, puis-je vous demander d’attendre encore? J’admets que nous ne nous ressemblons guère; mais je pensais, précisément, qu’il valait mieux, pour chacun de nous deux, que nous ne nous ressemblions pas trop. Je crois que, si je puis vous aider, c’est surtout par mes différences et par ce que je vous apporterais de neuf. Si je m’abuse, il sera toujours temps de m’en avertir. Je ne suis pas type à me plaindre, ni à récriminer jamais. Mais, écoutez, voici ce que je vous propose; c’est peut-être idiot… Le petit Boris, si j’ai bien compris, doit entrer à la pension Vedel-Azaïs. Sophroniska ne vous exprimait-elle pas ses craintes qu’il ne s’y sentît un peu perdu? Si je m’y présentais moi-même, avec la recommandation de Laura, ne puis-je espérer d’y trouver un emploi, de surveillant, de pion, que sais-je? J’ai besoin de gagner ma vie. Pour ce que je ferais là-bas, je ne demanderais pas grand-chose; le vivre et le couvert me suffiraient… Sophroniska me témoigne de la confiance, et Boris s’entend bien avec moi. Je le protégerais, l’aiderais, me ferais son précepteur, son ami. Je resterais à votre disposition cependant, travaillerais pour vous entre-temps, et répondrais au moindre signe. Dites, que pensez-vous de cela? »
Et comme pour donner à « cela » plus de poids, il ajouta:
« J’y pense depuis deux jours. »
Ce qui n’était pas vrai. S’il ne venait pas d’inventer ce beau projet à l’instant même, il en eût déjà parlé à Laura. Mais ce qui était vrai, et qu’il ne disait pas, c’est que depuis son indiscrète lecture du journal d’Édouard et depuis la rencontre de Laura, il songeait souvent à la pension Vedel; il souhaitait de connaître Armand, cet ami d’Olivier, dont Olivier ne lui parlait jamais; il souhaitait plus encore de connaître Sarah, la sœur cadette; mais sa curiosité demeurait secrète; par égard pour Laura, il ne se l’avouait pas à lui-même.
Édouard ne disait rien; pourtant le projet que lui soumettait Bernard lui plaisait, s’il l’assurait d’un domicile. Il se souciait peu d’avoir à l’héberger. Bernard souffla sa bougie, puis reprit:
« N’allez pas croire que je n’ai rien compris à ce que vous racontiez de votre livre et du conflit que vous imaginez entre la réalité brute et la…
– Je ne l’imagine pas, interrompit Édouard; il existe.
– Mais précisément, ne serait-il pas bon que je rabatte vers vous quelques faits, pour vous permettre de lutter contre? J’observerais pour vous. »
Édouard doutait si l’autre ne se moquait pas un peu. Le vrai, c’est qu’il se sentait humilié par Bernard. Celui-ci s’exprimait trop bien…
« Nous y réfléchirons », dit Édouard.
Un long temps passa. Bernard essayait en vain de dormir. La lettre d’Olivier le tourmentait. À la fin, n’y tenant plus, et comme il entendait Édouard s’agiter dans son lit, il murmura:
« Si vous ne dormez pas, je voudrais vous demander encore… Qu’est-ce que vous pensez du comte de Passavant?
– Parbleu, vous le supposez bien, dit Édouard. Puis, au bout d’un instant: – Et vous?
– Moi, dit Bernard sauvagement… je le tuerais. »
VII
Le voyageur, parvenu au haut de la colline, s’assied et regarde avant de reprendre sa marche, à présent déclinante; il cherche à distinguer où le conduit enfin ce chemin sinueux qu’il a pris, qui lui semble se perdre dans l’ombre et, car le soir tombe, dans la nuit. Ainsi l’auteur imprévoyant s’arrête un instant, reprend souffle, et se demande avec inquiétude où va le mener son récit.
Je crains qu’en confiant le petit Boris aux Azaïs, Édouard ne commette une imprudence. Comment l’en empêcher? Chaque être agit selon sa loi, et celle d’Édouard le porte à expérimenter sans cesse. Il a bon cœur, assurément, mais souvent je préférerais, pour le repos d’autrui, le voir agir par intérêt; car la générosité qui l’entraîne n’est souvent que la compagne d’une curiosité qui pourrait devenir cruelle. Il connaît la pension Azaïs; il sait l’air empesté qu’on y respire, sous l’étouffant couvert de la morale et de la religion. Il connaît Boris, sa tendresse, sa fragilité. Il devrait prévoir à quels froissements il l’expose. Mais il ne consent plus à considérer que la protection, le renfort et l’appui que la précaire pureté de l’enfant peut trouver dans l’austérité du vieil Azaïs. À quels sophismes prête-t-il l’oreille? Le diable assurément les lui souffle, car il ne les écouterait pas, venus d’autrui.
Édouard m’a plus d’une fois irrité (lorsqu’il parle de Douviers, par exemple), indigné même; j’espère ne l’avoir pas trop laissé voir; mais je puis bien le dire à présent. Sa façon de se comporter avec Laura, si généreuse parfois, m’a paru parfois révoltante.
Ce qui ne me plaît pas chez Édouard, ce sont les raisons qu’il se donne. Pourquoi cherche-t-il à se persuader, à présent, qu’il conspire au bien de Boris? Mentir aux autres, passe encore; mais à soi-même! Le torrent qui noie un enfant prétend-il lui porter à boire?… Je ne nie pas qu’il y ait, de par le monde, des actions nobles, généreuses, et même désintéressées; je dis seulement que derrière le plus beau motif, souvent se cache un diable habile et qui sait tirer gain de ce qu’on croyait lui ravir.
Profitons de ce temps d’été qui disperse nos personnages, pour les examiner à loisir. Aussi bien sommes-nous à ce point médian de notre histoire, où son allure se ralentit et semble prendre un élan neuf pour bientôt précipiter son cours. Bernard est assurément beaucoup trop jeune encore pour prendre la direction d’une intrigue. Il se fait fort de préserver Boris; il pourra l’observer tout au plus. Nous avons déjà vu Bernard changer; des passions peuvent le modifier plus encore. Je retrouve sur un carnet quelques phrases où je notais ce que je pensais de lui précédemment:
« J’aurais dû me méfier d’un geste aussi excessif que celui de Bernard au début de son histoire. Il me paraît, à en juger par ses dispositions subséquentes, qu’il y a comme épuisé toutes ses réserves d’anarchie, qui sans doute se fussent trouvées entretenues s’il avait continué de végéter, ainsi qu’il sied, dans l’oppression de sa famille. À partir de quoi il a vécu en réaction et comme en protestation de ce geste. L’habitude qu’il a prise de la révolte et de l’opposition, le pousse à se révolter contre sa révolte même. Il n’est sans doute pas un de mes héros qui m’ait davantage déçu, car il n’en était peut-être pas un qui m’eût fait espérer davantage. Peut-être s’est-il laissé aller à lui-même trop tôt. »
Mais ceci ne me paraît déjà plus très juste. Je crois qu’il faut lui faire encore crédit. Beaucoup de générosité l’anime. Je sens en lui de la virilité, de la force; il est capable d’indignation. Il s’écoute un peu trop parler; mais c’est aussi qu’il parle bien. Je me défie des sentiments qui trouvent leur expression trop vite. C’est un très bon élève, mais les sentiments neufs ne se coulent pas volontiers dans les formes apprises. Un peu d’invention le forcerait à bégayer. Il a trop lu déjà, trop retenu, et beaucoup plus appris par les livres que par la vie.
Je ne puis point me consoler de la passade qui lui a fait prendre la place d’Olivier près d’Édouard. Les événements se sont mal arrangés. C’est Olivier qu’aimait Édouard. Avec quel soin celui-ci ne l’eût-il pas mûri? Avec quel amoureux respect ne l’eût-il pas guidé, soutenu, porté jusqu’à lui-même? Passavant va l’abîmer, c’est sûr. Rien n’est plus pernicieux pour lui que cet enveloppement sans scrupules. J’espérais d’Olivier qu’il aurait mieux su s’en défendre; mais il est de nature tendre et sensible à la flatterie. Tout lui porte à la tête. De plus j’ai cru comprendre, à certains accents de sa lettre à Bernard, qu’il était un peu vaniteux. Sensualité, dépit, vanité, quelle prise sur lui cela donne! Quand Édouard le retrouvera, il sera trop tard, j’en ai peur. Mais il est jeune encore et l’on est en droit d’espérer.
Passavant… autant n’en point parler, n’est-ce pas? Rien n’est à la fois plus néfaste et plus applaudi que les hommes de son espèce, sinon pourtant les femmes semblables à lady Griffith. Dans les premiers temps, je l’avoue, celle-ci m’imposait assez. Mais j’ai vite fait de reconnaître mon erreur. De tels personnages sont taillés dans une étoffe sans épaisseur. L’Amérique en exporte beaucoup; mais n’est point seule à en produire. Fortune, intelligence, beauté, il semble qu’ils aient tout, fors une âme. Vincent, certes, devra s’en convaincre bientôt. Ils ne sentent peser sur eux aucun passé, aucune astreinte; ils sont sans loi, sans maîtres, sans scrupules; libres et spontanés, ils font le désespoir du romancier, qui n’obtient d’eux que des réactions sans valeur. J’espère ne pas revoir lady Griffith d’ici longtemps. Je regrette qu’elle nous ait enlevé Vincent, qui, lui, m’intéressait davantage, mais qui se banalise à la fréquenter; roulé par elle, il perd ses angles. C’est dommage: il en avait d’assez beaux.
S’il m’arrive jamais d’inventer encore une histoire, je ne la laisserai plus habiter que par des caractères trempés, que la vie, loin d’émousser, aiguise. Laura, Douviers, La Pérouse, Azaïs… que faire avec tous ces gens-là? Je ne les cherchais point; c’est en suivant Bernard et Olivier que je les ai trouvés sur ma route. Tant pis pour moi; désormais, je me dois à eux.



 ePub
ePub A4
A4